Text
Un principe prudent

Pour Jean-Pierre Raffarin, l'affaire Benalla est un « accident » pour un exécutif qui « a été lent et faible dans la gestion de cette crise ». Ce qui signifie qu'elle ne relève pas d'un problème de fond. Qu'elle ne participe pas à montrer, avec d'autres scandales, que l'exécutif a trop de pouvoirs et n'a plus à répondre de ce qu'il fait, officiellement ou non, ni devant le législatif (qui a perdu toute indépendance), ni devant les citoyens (qui ont perdu toute souveraineté). Jacqueline Gourault le disait bien le 19 avril à l'assemblée nationale : les ministres n'ont pas à répondre aux questions du parlement, que l'obliger à répondre et insister sont « des méthodes autoritaires » qui « ne sont pas acceptables dans une démocratie ». Scandale redoublé par la commission d'enquête fantoche qui loin de faire la lumière sur les responsabilités de chacun, n'a servi finalement qu'à noyer l'affaire.
Choix de mots plus que douteux déjà. Accident, c'est trop peu. Faible, si par là il voulait dire « inefficace », là chose est en débat.
Mais il va plus loin. Le principal problème que poserait cette affaire serait le rapprochement des extrêmes. C'est le discours éternel de l'exécutif. Il faut se souvenir, par exemple, de ces paroles de Macron, le 24 juillet : « Et nous assistons à la coalition baroque qui ne trompe personne dans notre pays, de ceux qui se prétendent provenir du gaullisme et qui en ont oublié tous les principes et la dignité. Et des extrêmes qui, eux, sont cohérents dans leur recherche : ils n'aiment pas l'Etat et ils veulent basculer la république. »
Ce qui donne, du côté de Raffarin : « [l'affaire] a donné une occasion de dialogue entre l'extrême droite et l'extrême gauche et offert une consistance à une opposition systématique ». « Le risque majeur pour Emmanuel Macron et pour la France, aujourd'hui, c'est le rapprochement des extrêmes, c'est-à-dire le scénario italien. » Cela sans doute pour masquer les rapprochements entre la droite et l'extrême droite, qu'il exprime à demi-mots à la fin de son interview quand il affirme que Wauquiez veut stimuler le « sentiment anti-Macron » et « se positionner fortement à droite ».
Mais quel est ce « scénario italien », quelle est la probabilité de ce rapprochement des extrêmes et que penser de ces prises de parole ?
Ce que Raffarin appelle le « scénario italien », c'est la coalition de la Ligue du Nord et du Mouvement 5 étoiles en ce moment au pouvoir. Mais si la ligue est bien d'extrême droite, le M5S n'est pas du tout d'extrême gauche. On peut même dire qu'il est en acte ce que En Marche n'est qu'en discours : un parti opportuniste, post-idéologique, ni de gauche ni de droite mais capable de prendre et chez les uns et chez les autres les idées qui sont en mesure de le faire gagner. En discours, c'est ce que proposait Macron, mais il fallait vraiment être dupe pour ne pas y voir la cape d'invisibilité de l'ultralibéralisme. Qui est, jusqu'à preuve du contraire, un courant idéologique ancré à droite. Le M5S affirme n'être ni de gauche, ni de droite et voter pour une loi si elle est bonne, ne pas voter pour elle si elle ne l'est pas. Du Macron tout craché. De plus, quand on observe la provenance des électeurs du M5S, on se rend compte qu'il sont très minoritairement de gauche. Plus nombreux sont les anciens électeurs de droite ou les nouveaux votants.
C'est pourquoi un tel rapprochement extrême droite-extrême gauche est impossible en France. D'abord parce qu'il n'existe pas même en Italie, ensuite parce que l'ancrage idéologique (le terme est mauvais, il faudrait parler de convictions) est trop fort pour permettre la moindre compromission. Marine Le Pen n'a pas de mots trop durs contre les syndicats, Mélanchon les soutient quoi qu'il arrive. Elle est pour la fermeture des frontières aux réfugiés, il est pour leur accueil. Même sur l'Europe il serait illusoire d'imaginer une entente possible : elle est pour resserrer la souveraineté sur le national seulement, lui pour une autre Europe, qui ne soit plus seulement économique.
Plus fondamentalement, on ne marie pas une extrême droite nationaliste et une extrême gauche internationaliste. Cela est une absurdité qui devrait faire sauter au plafond n'importe qui et étrangler ceux qui osent évoquer la chose. Mais cette absurdité, à force d'être répétée, semble vraisemblable.
C'est le principe de la répétition. Ce discours, pour le coup, idéologique, sert à faire croire que hors le centre, point de salut. Or, comme le centre se divise entre deux partis « de gouvernements » qui ne vivent plus que de leur opposition vide, le salut ne se trouve que dans un parti centriste, le mouvement En Marche. Sauf que ce parti, loin d'offrir le spectacle d'une république exemplaire, d'une vie politique soucieuse du bien public, offre plutôt le spectacle d'un Anschluss parlementaire. L'exécutif est de plus en plus puissant et les contre-pouvoirs exsangues. Le législatif est une annexe du gouvernement, le pouvoir judiciaire ? Et le pouvoir médiatique, si c'en est réellement, subit les foudres répétées de Macron, qui, ce faisant, rejoint les discours de Trump, du M5S, des extrêmes droites européennes. Et de Mélanchon. À se demander qui aujourd'hui ne tape pas sur les média. Or, leur principal défaut, on le comprend assez vite, c'est qu'ils font leur boulot. Le Pen exclut les journaux de ses meetings quand ces derniers s'intéressent de trop près à ses affaires, révèlent les détournements, les montages financiers, etc. ou quand ils sont trop critiques, Macron les critique quand ils révèlent des affaires qui mettent à mal l'image d'exemplarité qu'il s'est efforcée de construire, Mélanchon, lui, s'en prend surtout à l'éditocratie, mais aussi aux journalistes lorsqu'ils évoquent les enquêtes menées sur ses comptes de campagne.
Deux leçons à tirer de tout ça. Qui ne sont, de toute façon, pas neuves.
Plus les politiciens critiquent les journaux, plus on devrait se forcer à les lire. C'est qu'il y a dedans des choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache et qui les gênent considérablement.
On devrait considérer que toute déclaration officielle d'un politicien est une dénégation et là-dessus s'efforcer de démontrer la véracité du sous-texte. Sorte de méthode scientifique. Je ne montre pas que ce qu'untel dit est vrai ; je m'efforce de démontrer que le contraire est faux. Ainsi, si Macron ou Raffarin affirment que Mélanchon ou Le Pen s'efforcent de renverser la république, que lui, de facto, s'escrime à sauver, il faut comprendre que c'est Raffarin et Macron qui veulent renverser la République, et s'efforcer de démontrer cela. Fustiger les méthodes autoritaires des autres, c'est alors masquer son propre autoritarisme, dénoncer le danger que représente l'autre, c'est jouer l'agneau quand on le loup et quand l'un dit qu'il est parfaitement honnête, estimer que c'est là, déjà, une dissimulation.
0 notes
Text
The width of a circle (terror remix)
Alors on m'a dit que mon article précédent n'était pas des plus clairs. Sans doute à juste titre. Alors je vais la jouer plus simple. Lentissimo maestro !
Cette chanson, The Width of a circle, elle raconte une histoire, une histoire simple et sans fin. Qui se répète à l'infini. Une histoire à trois rôles, mais dont les personnages sont potentiellement infinis, chaque personnage incarnant tour à tour les divers rôles. C'est l'évidence même. Dans la vie, on est tour à tour le dindon puis la farce, quand on n'est pas un petit farceur. Là, ce que sont ces rôles, c'est simple, aussi simple et nu que dans une pièce de Beckett. Il y a l'individu replié sur lui-même, le bourgeon. L'individu réalisé, épanoui, la fleur. Et l'être qui provoque et accompagne le passage du premier au second, qui sont des rôles aussi bien que des stades, on pourrait dire l'être rayonnant, le soleil.
Cette histoire. Allez, soyons fous, disons cette pièce se joue en plusieurs scènes. Trois scènes. Parce que, comme le dit Verlaine, en musique, préférez l’impair. Mais évitez si possible les fausses notes et autres pains et trois, c’est bien. Parfait. Bien sûr, chacune de ces scènes porte le souvenir par anticipation de ce qui se jouera plus tard, dans les prochaines scènes. Et c’est beau, ça donne de l’épaisseur à la chanson. Mais ça c'est fatal aussi, c'est destin. C'est que l'histoire, cette histoire là, se répète à l'infini. C'est le récit d'un cycle d'inspiration qui roule d'homme en homme, de femme en femme, de star en star. Chacun s'inspire d'un autre pour devenir celui qu'il est. C'est Nietzsche dans cette chanson qui nous emmène en balade, pour une moustache ride.

Donc dans la première scène, le rôle du bourgeon est tenu par Bowie. Il faut savoir que Bowie ici est déjà un personnage, David Bowie est un pseudonyme, c'est une idée. C'est un Bowie balbutiant ici au début de la chanson, qui est replié sur lui-même, perdu, sans repères. Il se cherche, il cherche sa voie. Il croise le deuxième rôle, rôle de fleur épanouie, qui roupille sur le bord du chemin, attendant Godot comme Estragon. Sauf que c'est pas Estragon, c'est Zarathoustra. Zarathoustra, le sage absolu, celui qui allie l'esprit et le courage, celui qui annonce et le monothéisme premier et l'avènement de l'homme-dieu, de l'homme créateur de ses propres valeurs, de l'homme qui choisit sa propre voie. Et c'est pas étonnant que ce balbutiement de Bowie rencontre justement Zarathoustra. Mais ce Zarathoustra est l'image que Bowie projette de lui-même, c'est l'idée qu'il se fait de qui il pourrait être. Et le croiser sur le bord du chemin, c'est prendre la route qu'il indique. Suivre l'exemple.
C'est ce que l'on fait tous. On ne sait pas au début qui on est. On ne le sait jamais. Le but n'est jamais de le connaître. Le but, c'est de devenir quelqu'un de pas trop dégueulasse. Alors ça on le fait en prenant les modèles qu'il faut. Et puis ces modèles, le but, c'est pas d'être des sosies. Rien de plus triste qu'un sosie de Johnny qui oublie jusqu'à son propre nom, rien de plus triste qu'un sosie de Georges Michael faisant ses courses à Lidl. Le but des modèles, c'est d'être abandonnés au bord du chemin, comme les chiens en été le long de l'autoroute. Ce sont des marche-pieds. Des ponts entre le singe et celui qu'on peut espérer devenir, en y mettant beaucoup du sien. Donc c'est ça qui se passe au début.
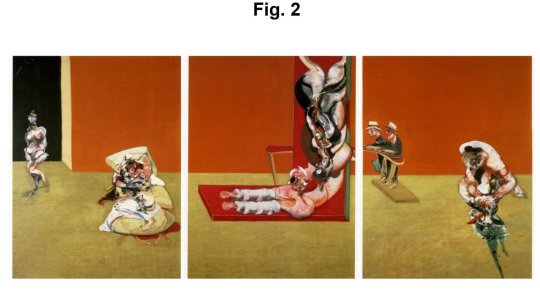
La deuxième scène est simple. C'est la rencontre avec l'individu flamboyant, Mick Jagger, Lindsay Kemp, american gigolo ou dieu-sait-qui. Et donc la deuxième scène, c'est la manière dont cet être exceptionnel pousse Bowie à abandonner toutes ses réticences pour se laisser emporter dans un tourbillon de débauche, ce qui franchement n'est pas génial, mais dont il va sortir transformé. Flamboyant lui-même. Et flamboyant enfin, devenu l'équivalent de Zarathoustra, enfin devenu Zaradeuxtra, Zarathoustrois, ou Infinithoustra va savoir, et il peut jouer le rôle de l'être accompli, de la fleur épanouie, qui servira de modèle à un personnage nouveau qui viendra endosser le rôle de l'individu perdu, du bourgeon timide. Ce nouveau personnage, c'est l'auditeur lui-même, projeté ainsi dans l'économie de la chanson, emporté dans l'orgie flamboyante où rôles et personnages se mêlent. On a là la troisième scène, dans les dernières paroles de la chanson.
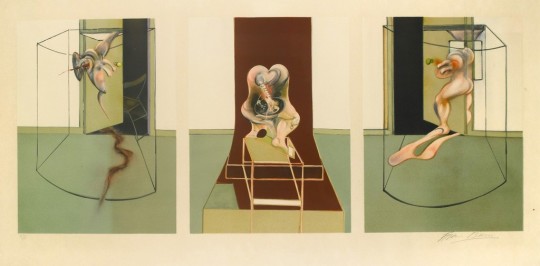
Ainsi, ce que l'on a, dans cette chanson, c'est David Bowie qui, tirant le bilan de sa vie, incarne tous les rôles importants, organise sa biographie imaginaire dans laquelle il se rencontre lui-même, se parle à lui-même à travers le temps. Ce qu'on fait tous un peu, et ce que le cinéma fait souvent. Freaky Friday, et autres films du même genre. Donc ici il tire les leçons du passé. Si on peut dire les choses ainsi, et le fait en usant de références littéraires qui guident vers une certaine compréhension de ce qui se passe, et en usant de changement de rythme, de musique, en usant de ruptures, pour indiquer les changements de scène.
0 notes
Text
Le cercle et le vampire
L'album s'ouvre sur une chanson assez prog, un peu heavy, qui a souvent été analysée comme une chanson sur le rapport entre Bowie et ses personnages, qui l'écraseraient, l'empêcheraient d'être pleinement lui-même. Ce que Bowie a toujours contesté, et pour cause, cette lecture plaque sur Width of a circle ce qui peut être dit de Man who sold the world.
Le titre est d'essence mathématique ; width, c'est le diamètre. Le diamètre divise une forme géométrique sur sa plus grande longueur. En deux parties égales. Il y a donc l'idée ici d'un être qui se divise intérieurement en deux, qui donne naissance en lui à deux être opposés mais pourtant identiques, comme la scissiparité au sein d'une cellule qui meurt en donnant naissance à deux nouvelles cellules identiques à elles-mêmes. Il y a donc bien un rapport aux créations intérieures de Bowie, à ses personnages, mais plus rigoureusement, la chanson est sur son évolution, son développement et la manière dont il devient chanteur. Ce qui pour lui est aussi une manière de devenir lui-même. Il y a division, mais il est important de noter qu'il n'est pas question de scission, de séparation, peut-être plus justement d'introspection et d'un regard rétrospectif porté par un David Bowie qui ne se reconnaît pas dans ce qu'il regarde, c'est à dire dans qui il a été et qui évoque, de manière poétique, impressionniste, les étapes qui lui ont permis d'être plus en accord avec lui-même. Ce qui est confirmé par les propos de Bowie, qui a écrit cette chanson et plusieurs autres de l'album à un moment de grande dépression, comme des moyen d'introspection, de retour sur lui-même, afin de résoudre des conflits qui lui pesaient, afin, comme on dit, de se retrouver.
In the corner of the morning in the past
I would sit and blame the master first and last
All the roads were straight and narrow
And the prayers were small and yellow
And the rumour spread that I was aging fast
Ainsi la chanson s'ouvre sur une évocation de l'enfance de Bowie, de ce qui semble être une révolte précoce face à Dieu et à l'hypocrisie de la religion, révolte qui permettrait de comprendre son attrait de jeune enfant et d'adolescent pour le bouddhisme, attrait si fort qu'il envisagea même un temps de devenir moine plutôt que chanteur. C'est peut-être aussi une révolte plus globale face au monde et à la société, face à une absence de perspective réjouissante ouverte devant lui. Toutes les routes qu'il voit s'étendre devant lui sont étroites, faites pour ceux qui n'ont aucune ouverture d'esprit. Ce qui l'amène à éprouver haine et ressentiment, à devenir ce monstre qu'il croise au bord du chemin, mais un monstre endormi, qui n'exprime pas sa révolte. À cause de la timidité de Bowie, cette colère reste intérieure et il se consume dans cette haine qu'il garde en lui.
Then I ran across a monster who was sleeping by a tree
And I looked and frowned and the monster was me
Well, I said hello and I said hello
And I asked Why not?" and I replied "I don't know
So we asked a simple black bird, who was happy as can be
And he laughed insane and quipped Khalil Gibran
S'ensuit un dialogue entre les deux moitiés identiques, dans l'esprit des textes de Gibran, relativement comique et qui ne peut aboutir. Alors ils demandent de l'aide à un oiseau noir qui refuse de leur répondre et, hilare, parodie ou se moque du poète libanais. Au delà de la volonté de paraître dans le coup, qu'est-ce que cette drôle de scène peut bien vouloir dire ?

Gibran accorde beaucoup d'importance aux oiseaux, qui sont pour lui en général tout à la fois symbole de libre pensée et d'être accompli.
Dans un de ses textes en effet, il dit que les émotions, la haine comme l'amour, sont comme des oiseaux nichés dans un murs. Les pensées positives sont des oiseaux blancs, qui ne peuvent nicher que dans des niches faites pour eux, les pensées négatives des oiseaux noirs qui ne peuvent nicher que dans des niches faites pour eux. Dès lors, dès qu'on maudit quelqu'un, qu'on le hait, et Gibran a écrit quelques histoires en ce sens, on envoie vers la personne un oiseau noir, libérant ainsi en soi une niche mauvaise, la laissant ouverte aux oiseaux de mauvaise augure, leur permettant d'altérer notre être et nos pensées, de faire de nous des personnes mauvaises et nous menaçant directement (Gibran fait le récit par ailleurs d'un homme qui a maudit son gendre et l'a tué ainsi de son oiseau noir. Mais d'autres lui ont assombri l'âme, car alors même qu'il se lamentait d'avoir ainsi perdu gendre et fille, tirait orgueil de la puissance de ses malédictions, ruinant toutes ses chances d'absolution). Alors que si on garde pour soi ses malédictions, on devient insensible à la haine des autres, inattaquables. Purement bon et bienheureux, non dévoré par la haine.
D'où certainement la précision sur la couleur de l'oiseau. Ils lui ont ainsi certainement demandé de porter leur haine, et leur débat à la Beckett aurait alors été un débat sur la pertinence de haïr et maudire le monde, une haine de pure façade, comme un premier rôle déjà, dans laquelle aucune des deux moitiés ne croit. C'est pour cela que l'oiseau s'envole en riant, parce qu'il n'a aucune haine à porter. C'est une révélation pour Bowie, qui prend alors en pitié ceux qu'ils détestaient, prenant par là la mesure de leur misère et faisant l'étrange découverte que « Dieu, lui aussi, est un jeune homme ».
And I cried for all the others untill the day was nearly through
For I realized that God's a young man too
So I said "So long" and I waved bye-bye
And I smashed my soul and traded my mind
Got laid by a young bordello
Who was vaguely half asleep
For which my reputation swept back home in drag
And the moral of this magic spell
Negotiates my hide
When God did take my logic for a ride
Peut-être là encore une réminiscence de Nietzsche et du bouddhisme, les deux de toute façon n'étant pas nécessairement à opposer. Bouddhisme et hindouisme ont été redécouverts en Europe à la fin du XVIIIe siècle, en Allemagne surtout, où ces spiritualités nouvelles ont joui d'une importance considérable sur tout le XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, avec un moment ésotérique, new age déjà, considérable, qui opposait les religions abrahamiques à ces religions orientales, faisant même du Christ un représentant de l'hindouisme (un aryen) récupéré et détourné par les sémites, important aussi pour la philosophie, pour un penseur comme Schopenhauer en particulier, qui fut le maître à penser de Nietzsche. La haine vient de ce que l'on a une idée trop figée et par nature mensongère de soi et des valeurs. On va haïr ce qui s'oppose à des valeurs que l'on croit fixes et sûres, écrites dans le marbre par un dieu ancien et donc sage, la sagesse étant attachée à la barbe blanche. Mais si Dieu est un jeune homme, s'il est plus fils que père et plus Christ au torse nu qu'autre chose, il est un dieu qui se cherche et se réinvente, un dieu qui doit se transformer, qui doit évoluer, qui ne peut donc pas inscrire ses lois dans le marbre. Il est le dieu enfant, créateur, qui réinvente les règles, qui change les tables de la loi, il est le Dieu enfant que Nietzsche emprunte à Héraclite. Ce pour quoi Bowie éclate son âme et échange son esprit, on pourrait dire, sa personnalité. Parce qu'elle-même n'est qu'une illusion et jouer avec cette illusion est un moyen d'atteindre une vérité plus profonde.

Et c'est très intéressant parce que cela, ce qu'annonce faire Bowie ici, au niveau du rock, c'est très exactement ce que fait Andy Kaufman dans l'univers de la comédie. Bowie est la moitié musicale de Kaufman, ou Kaufman la moitié pince-sans-rire de Bowie, ils sont les deux moitiés scissipares d'une même entité dont le but avoué est de changer les représentations et libérer les individus de l'individualité qu'ils croient devoir endosser, des règles qu'ils s'imposent et dont ils souffrent parce qu'ils les croient immuables. Entité dont le but est de jouer avec la tête des gens, comme le dit Kaufman. Pas pour les ridiculiser. Pour les libérer. Bowie le disait à sa manière, évoquant la période hippie : il disait que beaucoup de jeunes avaient besoin de ces groupes exubérants, de ces expériences radicales pour se libérer des règles et pouvoir imaginer d'autres manières d'être et de faire, pour se dire que finalement « il y a une place dans ce monde pour celui que l'on veut être et pour ce que l'on veut faire, aussi folle que cette chose soit. »
Et donc, avec cette personnalité en miettes, Bowie se livre à une réinvention bisexuelle de lui-même avec un être bohème, cette entité primordiale qui l'enfantera comme un double et qui se faisant ruinera dans un premier temps sa réputation. Mais d'un autre côté, cette conversion, ces nouvelles idées l'aident profondément à dépasser sa timidité. Elles trouvent un moyen de déchirer le voile, de surmonter cette tendance qu'il avait à se dissimuler (negociates my hide) ; il est ainsi prêt à être une rockstar, à être un porteur de masques populaires.
C'est là que sa logique est déjouée ; qu'il devient donc soit un être fantasque, si cette logique est la logique au sens où on l'entend, un esprit de conséquence et de responsabilité, soit qu'il commence à souffrir de ce choix Kaufmanien qu'il a fait, si la logique et celle de l'impermanence des choses. Ce qui est sûr, c'est que la logique de la chanson est perturbée, elle change d'allure à ce moment là. Totalement. Et de récit. Et de personnage. Et se concentre sur ce Bordello, ce prostitué bohème à la fois Dieu, artiste et magicien.
He swallowed his pride and puckered his lips
And showed me the leather belt round his hips
My knees were shaking my cheeks aflame
He said, you'll never go down to the Gods again

Cet être pourrait bien être Lindsay Kemp, mais cette description pourrait tout aussi bien se rapporter à Mick Jagger, avec qui, quelques temps après la chanson, il connaîtra une passion torride et bien connue. Mick Jagger, connu surtout pour la manière très caractéristique qu'il a de tordre ses lèvres, a littéralement émerveillé le tout jeune Bowie quand ce dernier l'a vu en concert, qui voyait dans le jeune chanteur hypersexualisé l'avenir de la musique, un spectacle en parfaite rupture avec tout ce qui avait précédé. Ce qui servi peut être en partie de modèle à Bowie pour se lancer. Mais après on se croirait retombé dans un récit de Khalil Gibran : ce dieu serpent l'emmène, ou ce diable serpent, l'emmène dans les profondeurs de la terre dans un circuit de montagnes russes magiques qui l'excite au plus haut point, dans lequel les évocations bibliques ou ésotériques le disputent aux sous-entendus sexuels.
He struck the ground, a cavern appeared
And I smelt the burning pit of fear
We crashed a thousand yards below
I said, do it again, do it again
His nebulous body swayed above
His tongue swollen with devil's love
The snake and I, a venom high
I said, do it again, do it again
Breathe, breathe, breathe deeply
And I was seething, breathing deeply
Spitting sentry, horned and tailed
Waiting for you
Métaphore appuyée des amours mâles (la caverne, le corps qui « sway », qui se balance d'avant en arrière au dessus, le serpent, le fait de respirer bruyamment, répété deux fois qui mime littéralement le souffle haletant de l'amant, le crachat du corps au garde à vous, le fait d'être excité et baisé (horned and tailed, etc.), évocation lointaine du serpent de Khalil Gibran qui connaît tous les secrets de la terre, ou de la vipère qui empoisonne le Zarathoustra de Nietzsche alors que ce dernier dort sous un arbre ? Mélange orgiaque de tout cela et pirouette narrative.
Le récit de Gibran, le savant et le poète, présente un serpent et un oiseau qui discutent, mesurant leurs mérites respectifs. Le serpent a vu « les cavernes où la sève de la vie coule en silence », a aperçu « les secrets des profondeurs, a évolué parmi les trésors des empires souterrains », « il connaît une plante qui s'enracine dans les entrailles de la terre et qui mange de ces racines devient plus beau encore que la déesse Astarte » et poursuit de la sorte, alors que l'oiseau moqueur (Lark, l'alouette, est aussi la chose que l'on fait pour s'amuser) ne trouve à répondre, pour énerver le serpent, que « tu es bien savant c'est sûr, mais quel dommage que tu ne sache ni voler ni chanter », montrant ainsi le manque d'élévation et de gaîté du serpent, qui s'en retourne mécontent à ses études. Une référence qui semble malgré tout renvoyer ce bordello à l'image de Kemp, qui était une véritable créature mythique pour Bowie, qui l'étudia comme une curiosité, comme un artiste accompli et parfait. Mais qui prenait sa relation avec son élève Bowie très au sérieux, même au tragique, là où Bowie se voulait très libre, absolument libre, comme les oiseaux de Gibran.
Le récit de Nietzsche est plus étrange encore. Zarathoustra dort sous un arbre et un serpent le mord au cou. Zarathoustra se réveille et plutôt que de s'énerver le remercie de l'avoir réveillé, car il a encore beaucoup de route à faire. Le serpent le prévient qu'il va mourir bientôt, à cause du poison. Ce à quoi répond Zarathoustra que jamais un dragon n'est mort du venin d'un serpent, et lui conseil de reprendre son poison, car il n'en n'a pas assez pour se permettre de lui en offrir. Ce à quoi le serpent s'enroule autour du cou de Zarathoustra pour le lui sucer. La morale de cette histoire, Nietzsche la donne tout de suite, mais comment la comprendre ? Bowie lisait beaucoup Nietzsche mais n'y comprenait pas grand chose, de son propre aveu. Quel usage fait-il alors de ce passage ? Il en manifeste l'aspect sexuel et insiste sur la proximité entre les deux personnages, le serpent et le dragon, l'un pensant donner quelque chose à l'autre, qui en manquerait, alors qu'il en a à profusion. Ce n'est évidemment pas du venin, ni des éjaculats, mais peut-être du talent. Bowie a beaucoup pris à Kemp, beaucoup appris de lui. À bouger, à transmettre des émotion en restant pourtant immobile. De l'expérience. Mais au fond, ce qu'il a tiré de Kemp, c'est ce que Kemp avait déjà trouvé en lui, ce que Bowie a tiré, il ne l'a pas tiré de Kemp, mais de lui-même, sous la direction de Kemp. Ainsi, le serpent n'est pas tellement Kemp ici que Bowie, face à un monstre plus fabuleux encore, plus puissant et plus grand ; c'est Bowie voulant terrasser le dragon. Les rôles, les places et les personnalités sont ici confondues, entremêlées. Plutôt : interchangeables.

Mais le plus intéressant, c'est que cette référence à Nietzsche tord la chanson sur elle-même, la replie et l'achève de cette manière étrange qui rappelle les films de Lynch, perturbés par un twist terrifiant qui ramène le film au début, répète l'histoire, mais d'un autre point de vue. Une manière de refermer le cercle. Au début, Bowie rencontre un monstre et ce monstre est lui-même. Mais on découvre ici que ce monstre en fait est probablement un autre artiste, plus grand que lui, qui l'initie et le fait grandir. Artiste que Bowie avait intériorisé comme modèle, à partir duquel il s'était don dédoublé. Bowie serpent croit vampiriser Kemp, aspirer son talent, le mettre à mort, lui petite créature face au grand monstre sacré, mais il se rend compte que Kemp est plus puissant. Si Bowie a grandi, c'est parce qu'il a « avalé cette furieuse gorgée de poison » comme dit Rimbaud, qu'il avait lui-même sécrété. Grandissant de la sorte en arrachant à son modèle ce qu'il y avait lui-même projeté, il devient lui-même un grand artiste, en développant son propre talent, devient lui-même un dragon. Et c'est ce dragon qu'il envoie dormir sous un arbre, près d'un chemin, attendant que passe un nouvel individu, l'auditeur, afin de l'aider à déployer son potentiel.
C'est le sens des personnages qu'incarne David Bowie, montrer que ses auditeur ont du génie en eux et qu'ils ne doivent pas hésiter à l'exprimer à leur manière, ce que les Mamas and the papas chantaient pendant la période hippie. Or dans cette chanson, il y a des rôles : le jeune qui se cherche, le pygmalion, l'artiste qui se réalise, et trois personnes : Bowie, l'auditeur, et Kemp (ou Mick Jagger, ou un mélange des deux). Et tous occupent les divers rôles alternativement, comme sur un théâtre. On suit d'abord Bowie, il change de rôle au contact du pygmalion, mais ce pygmalion, il l'a déjà rencontré sous une autre forme, ne le sait pas encore ; il ne peut le savoir qu'à la fin, lorsque lui-même, devenu artiste accompli, s'apprête à changer de rôle pour guider de nouvelles personnes, mais pas de nouveaux personnages : les personnages sont immuables, les personnes elles s'écoulent en eux et changent, les endossent pour un temps avant d'en changer, si bien qu'en eux-mêmes ils ne sont rien, seuls les rôles sociaux sont et sont importants.
Sans doute Zarathoustra dit quelque chose de cette sorte, lorsqu'il dit qu'en terme de disciples il ne veut pas des suiveurs, qui admirent qui il est, mais des créateurs ingrats qui s'inspire de ce qu'il dit pour faire ce qui leur convient de leur côté.
Si bien qu'à la fin de la chanson, Bowie s'égale à Nietzsche, à travers la figure du Zarathoustra endormi sous l'arbre, comme le bordello lui-même était à moitié endormi, et fait de l'auditeur son disciple transitoire, se faisant lui-même bordello, prostitué bohème, tel qu'il apparaît sur la pochette de l'album.
Et ça, c'est cosmique. Et c'est tordu.
1 note
·
View note
Text
Qu’est-ce qu’une rock-star au juste ?
Qu'est-ce que la musique pop et qu'est-ce qu'une rock-star ? C'est questions en « qu'est-ce que ... » sont toujours mal posées et sont le tombeau de toute philosophie si on les prend trop au sérieux. La véritable réflexion commence quand on cherche la différence entre une rock-star et un guitar-hero, ou un songwriter. Le guitar-hero n'est pas que celui qui joue de la guitare dans un groupe, le songwriter celui qui en écrit les paroles. Le guitar-Hero est avant tout un virtuose et se manifeste comme tel par sa technique, ses mélodies, mais c'est son importance historique surtout qui le consacre, son influence musicale sur les autres groupes, les auditeurs, etc. Le song-writer lui se définit plutôt comme un rouage d'une machinerie économique. Ainsi, il semble évident que la rock-star ne se définit pas seulement par des éléments musicaux, comme le guitar-hero, qu'elle ne soit pas qu'un musicien ou qu'un chanteur de rock. On peut en dire autant de la pop-star, qui n'est le plus souvent que la chose des producteurs et des maisons de disques, et ne fait pas grand chose si ce n'est donner une identité visuelle forte à un produit musical. Ce pourquoi des philosophes peuvent dire que la musique pop n'est que secondairement musique, dans le cadre d'une approche que l'on appelle « intertextualité radicale ». Ainsi David Shumway :
« Je ne me contente pas simplement de dire que le rock est une forme musicale impure ; j'affirme même que le rock n'est pas principalement une forme musicale »
ce qui permet de dire que comprendre un groupe de rock, c'est moins analyser sa musique, analyser la construction de ses chansons et le processus d'écriture que dénouer l'écheveau culturel que le groupe constitue, lier ce que le groupe fait et représente à tout ce qui a été fait avant, à ce qui a existé pendant, à ceux qui y puiseront inspiration. Ce qui n'est évidemment pas le cas avec la musique classique. On pourrait pour cela s'appuyer sur les concepts de post-modernisme et de convergence, respectivement de Lyautard et Jenkins, en les détournant quelque peu. La fin des grands récits, c'est la fin du cloisonnement des univers de sens, la fin du caractère suffisant des explications et des univers symboliques. Ainsi la musique n'est pas réductible à des éléments musicaux, à l'histoire de la musique. Ainsi expliquer la musique, telle musique ou tel morceau, ne peut plus se réduire à la simple exhibition de ses qualités (à la fois caractéristiques et mérites). Il faut faire converger les niveaux d'explications, de lectures, pour venir étayer l'explication musicale, qui devient dès lors assez secondaire. C'est, on pourrait dire, une lecture multimédia de la musique.
Mais secondaire en quel sens ? En terme d'importance ? Il serait alors plus pertinent de décrire la musique rock ou pop comme n'importe quel autre produit culturel, comme n'importe quel produit qui participe à une ambiance culturelle ou à un mode de vie. Mais on peut envisager cette importance simplement comme quantitative. Il y a évidemment plus d'éléments exogènes à développer qu'endogènes, musicaux, mais l'élément qu'il convient avant tout d'analyser est la musique, les éléments extérieurs ne servant qu'à étayer, justifier les choix musicaux particuliers.
Ainsi, pour expliquer The man who sold the world, d'après ce radicalisme intertextuel, c'est parler de ce dont parle Bowie, de ce qui soutient son écriture et son apparence—on serait tenté de dire son apparition. C'est faire tout autre chose que de la critique musicale, qui, à suivre Adorno, de toute façon n'est plus possible puisque le goût musicale a totalement disparu, laissant place à un fétichisme des œuvres. Fétichisme auquel invite les termes d'idoles et de fan(atique). Déradicaliser ce mode d'interprétation reviendrait d'abord à se pencher sur la musique elle-même, pour ensuite rattacher tel élément à telle influence ou à tel élément extérieur.
Je pourrai suivre John Seabrook et prendre l'exemple de starlettes préfabriquées, ou des rock-star qui plus manifestement ont plus existé à travers ce qu'elles incarnaient qu'au travers de leur musique, qui ont été des portes d'entrée dans la culture, forçant leurs fans à d'infinies recherches, mais pour le moment, c'est de David Bowie dont il est question. Et d'un album en particulier. Plus précisément d'une chanson. Mais il est certain que Bowie, étant un chanteur qui a multiplié les masques, qui a eu des phases, des périodes, s'est essayé à tous les styles ou presque, ne peut pas être réduit à un musicien prisonnier d'une sphère musicale. Ses revirements dépendent d'éléments exogènes, extérieurs, biographiques, culturels, dépendent de la vogue, qui orientent ou perturbent une recherche artistique. Pour l'expliquer donc, il faut sortir presque entièrement de la musique, ce qui semble confirmer les propos de Shumway. La musique n'est qu'un effet du monde.
Ainsi va-t-on approcher the man who sold the world par le biais d'une intertextualité radicale. Non pas comme chanson, non pas comme album, mais comme nœud de références, pour l'expliquer, non plus pour l'utiliser. Qu'est-ce que David Bowie, ce Ziggy Stardust, ce chanteur cosmique ? Il est, comme Bowie le disait lui-même dans ses entretiens avec Barry Miles, le pur produit des années 60. Avoir été adolescent dans les années 60 a été extraordinairement important pour lui, dans sa musique. C'est à la fois une époque riche, culturellement, richesse que l'on retrouve dans les paroles des chansons, mais c'est aussi une époque où tout semblait possible ; idéal que Bowie défend à sa manière. Quelque soit la chose que l'on veut faire, disait-il, aussi folle qu'elle puisse paraître, il faut la faire, il y aura toujours des gens d'une part pour apprécier, d'autre part pour faire plus fou quoi qu'il arrive ; faire ce que l'on a en tête, réaliser ses idées, c'est la chose la plus saine à faire, plus saine en tout cas que de se fixer des limites et de ruminer. Seulement voilà, problème de taille, Bowie est timide et sa timidité l'empêchait absolument d'incarner cet idéal de liberté. Comme le disait si bien Oscar Wilde, donnez un masque à un homme, il vous dira la vérité. Ce masque, c'est d'abord David Bowie lui-même, pseudonyme derrière lequel David Robert Jones se cache. Puis les nombreux autres visages, avatars d'avatars : Ziggy, Aladdin, etc. Masques derrière un masque, masque porté jusqu'à la fin puisque pour son dernier album, Bowie se masque les yeux derrière des bandages, continue d'incarner, quand les journalistes disent de lui qu'il a enfin tombé les masques et chante en son nom propre.
Ces personnages ne sont pas seulement une nécessité pour oser monter sur scène. Ils sont tout à la fois une stratégie et un héritage. Une stratégie, parce qu'il faut bien se distinguer et marquer les esprits, trouver un visuel et une mise en scène qui accrochent immédiatement, mais aussi parce que cela commence à être un trait d'époque et qu'il faut rester à la pointe. C'est un héritage surtout, du théâtre d'avant-garde, du ballet de Lindsay Kemp, chorégraphe important et amant de Bowie à l'époque. C'est Lindsay Kemp qui l'ouvre à la bisexualité, à Jean Genet, à la théâtralité. Bowie, aux dires de Lindsay, en parfait vampire, lui prendra tout, s'inspirera de tout ce que Lindsay a construit pour élaborer ses personnages, sa carrière. Picasso était comme ça aussi. Matisse disait qu'il n'aimait pas montrer ses tableaux en cours à Picasso parce qu'il trouvait toujours un élément à y reprendre pour en faire quelque chose de bien meilleur. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce que fait Bowie est meilleur que ce que fait Kemp, mais ce qu'a fait Bowie, c'est apporter le théâtre contemporain à un public plus large. C'est peut-être en partie cette rencontre qui est évoquée dans la chanson Width of a circle, qui ouvre l'album, encore que la description de l'amant qui y est donnée semble plus renvoyer à Mick Jagger, qu'il découvre sur scène en 1963 (réelle découverte, il dira plus tard qu'il découvrit avec les Rolling Stones ce qu'allait être la musique à l'avenir, pas tant pour la musique sans doute que pour l'énergie et la liberté qui s'en dégageait), avec qui il entretiendra une liaison dès 1973. Ainsi on peut dire que Bowie est avant tout le carrefour où se rencontrent le théâtre contemporain, une philosophie hip (Gibran, Nietzsche), une culture populaire tournée vers la science fiction, une musique qui très vite se tourne vers une appropriation parfois à la limite du pastiche du rock qui émergeait à l'époque (heavy, progressif, glam), un mode de vie boème et décomplexé qu'il s'efforce d'incarner, poussé en cela par sa première femme, Angela Barnett.
0 notes
Text
Blood-red and purple, green and blue (TMWSTW)
Il est temps pour moi de rencontrer mon animal totem et de me laisser glisser plus avant dans la chanson. Joie et bonne humeur. The man who sold the world prend place dans un album : The man who sold the world. On ne peut pas dire que c'est là un album concept, mais il y a une grande unité dans les chansons, qui présentent toutes le monologue d'un être exclu, rejeté, marginal, désaxé, aliéné, etc. Toutes, sauf la dernière qui, en guise de conclusion, semble faire de tous ces êtres non des victimes ou des individus à corriger mais des surhommes nietzschéens. Ce qui est tordu et osé, mais soit.

On va s'y glisser par la petite porte, la toute petite, par la cheminée de l'intertextualité. Mettre en lien le texte des chansons de l'album et les textes qui ont pu les inspirer ne va évidemment pas livrer tout de suite le sens des chansons, mais il permettra de mieux comprendre comment ces chansons ont été écrites et ce qui se trouve à leur origine. Ce qu'elles exploite. Cela ne peut qu'en éclairer le sens. Ne serait-ce qu'un peu. On peut ainsi tisser un réseau de références, comme une toile d'araignée, qui va emprisonner les chansons et sur lequel elles vont vibrer et faire résonner les autres. On aura ainsi une sorte de table d'harmonie, un ensemble structuré de références—littéraires et musicales—qui viendra amplifier la signification des chansons et leur portée.

Mais remarquons que déjà la couverture de l'album (David Bowie allongé dans un salon, jouant aux cartes dans une robe), est une illustration directe du poème d'un peintre, Dante Gabriel Rossetti : the card dealer. Dans lequel une femme fait tomber une à une les cartes d'un jeu sur le sol, devinant par avance la carte qu'elle s'apprête à tirer. C'est un jeu qu'elle joue avec tous, et que personne ne peut gagner, puisque ce jeu n'est autre que la vie et elle la mort.
Ce personnage est double, c'est vite vu. Sa description commence comme une allégorie de l'amour, mais c'est un topos du XIXe (issu du christianisme assurément) que de réunir la mort et l'amour sous la même forme ou d'en faire des sœurs, voire des amantes. Il suffit de lire Flaubert. Rien d'étonnant à ce que Rossetti use de ce poncif : il est un peintre préraphaélite, du XIXe donc, pour qui l'inspiration majeure était le moyen-âge finissant. Ce qui intrigue particulièrement dans ce poème, c'est que le regard de cette femme, que l'on boirait comme du vin, regard dont on s'enivre, recèle comme « une chanson dans une chanson », révèle dans ses prunelles la nuit entortillée. La nuit, étant aussi bien la mort, qui rôde autour de plusieurs des désaxés de Bowie, que la part d'ombre, la face obscure, qu'ils portent en eux.
Double aussi par la carte que Bowie tient dans sa main, le Roi de Carreau. Bowie aimait beaucoup le tarot, la divination et il y a fort à parier que ce choix n’est pas anodin, incarnant la mort, de se présenter, si la carte le représente, comme un être sage et puissant agissant avec une grande détermination. Comme le personnage de The Width of a circle, en quelque sorte.
Could you not drink her gaze like wine?
Yet though its splendour swoon
Into the silence languidly
As a tune into a tune,
Those eyes unravel the coiled night
And know the stars at noon.
Chanson sur laquelle on danse, chanson dont le rythme, celui des cartes qui s'écrasent au sol, est celui d'un cœur qui bat. Chanson dans une chanson ; c'est l'intertextualité même adaptée à la musique et à la méthode d'écriture de Bowie. Ce sont les chansons qui derrière les paroles cachent d'autres paroles, celles des livres et chansons cités, ce sont tous ces personnages qui derrière leur visage offrent un autre visage. C'est la double lecture de tous ces personnages comme des ratés ou comme des dieux, comme des êtres « bénis ou bannis ».
Double lecture encore, puisque cette image, et donc ce poème, semble se connecter aux chansons également, à After all essentiellement (« please trip them gently they don't like to fall »), qu'elle vient illustrer de manière lointaine.
Lointaine, car Bowie est assez peu structuré dans ses références. Il n'hésitait pas à insérer des références pointues, ésotériques, prisées des milieux arty, comme clin d'oeil, pour être dans le coup. Il les utilise plus comme des signes. Et quand les références utilisées lui tiennent à cœur, il les transforme assez pour qu'elles ne soient presque méconnaissables : comme il le dit dans une interview, il « s'efforce d'assembler dans ses textes des éléments qui l'intéressent et de circuler à travers eux, tant et si bien qu'ils s'intègrent dans une chanson à la fin ». Charge aux auditeurs après de recoller les morceaux, de rechercher les inspirations, de voir si cela colle aux paroles. De se faire leur propre idée.
« All I try to do in my writings is assemble points that interest me and puzzle through it and that becomes a song and other people who listen to that song must take what they can from it and see information that they've assembled fits with anything I've assembled. »
THE CARD DEALER, Dante Gabriel Rossetti
Could you not drink her gaze like wine?
Yet though its splendour swoon
Into the silence languidly
As a tune into a tune,
Those eyes unravel the coiled night
And know the stars at noon.
The gold that's heaped beside her hand,
In truth rich prize it were;
And rich the dreams that wreathe her brows
With magic stillness there;
And he were rich who should unwind
That woven golden hair.
Around her, where she sits, the dance
Now breathes its eager heat;
And not more lightly or more true
Fall there the dancers' feet
Than fall her cards on the bright board
As 'twere a heart that beat.
Her fingers let them softly through,
Smooth polished silent things;
And each one as it falls reflects
In swift light-shadowings,
Blood-red and purple, green and blue,
The great eyes of her rings.
Whom plays she with? With thee, who lov'st
Those gems upon her hand;
With me, who search her secret brows;
With all men, bless'd or bann'd.
We play together, she and we,
Within a vain strange land:
A land without any order,—
Day even as night, (one saith,)—
Where who lieth down ariseth not
Nor the sleeper awakeneth;
A land of darkness as darkness itself
And of the shadow of death.
What be her cards, you ask? Even these:—
The heart, that doth but crave
More, having fed; the diamond,
Skilled to make base seem brave;
The club, for smiting in the dark;
The spade, to dig a grave.
And do you ask what game she plays?
With me 'tis lost or won;
With thee it is playing still; with him
It is not well begun;
But 'tis a game she plays with all
Beneath the sway o' the sun.
Thou seest the card that falls,—she knows
The card that followeth:
Her game in thy tongue is called Life,
As ebbs thy daily breath:
When she shall speak, thou'lt learn her tongue
And know she calls it Death.
0 notes
Text
I ain’t afraid of no ghosts !
youtube
The man who sold the world passe pour une chanson difficile à comprendre. Loin de moi la prétention de dire que j'en ai percé le sens. Mais est-ce bien cela qu'il faut faire ? Il faut plutôt, dans la continuité de ce que l'on peut en comprendre, exploiter ces paroles pour les faire jouer de concert avec ce que l'on peut vivre. Ce qui n'est pas à proprement parler interpréter, ni adapter, mais c'est ce que l'on appelle s'emparer d'une chanson. Et il n'y a de capture de sens que parce qu'avant tout on est captivé ; il faut qu'une chanson nous tienne sous son emprise pour qu'elle soit comprise de nous à nouveau frais, qu'elle soit réactualisée. Ce miracle, ou ce mirage, interprétatif, est rendu possible par l'écriture de Bowie, qui demeure avant tout équivoque et ouverte, par son silence quant à la signification de ses chansons. Il est toujours resté évasif à ce sujet, et ce à juste titre :
« My writing is almost impressionistic. It's about the feeling. I'm not good at articulating specific situations. »
Son écriture ne délivre pas une idée précise ni ne forme un récit structuré, elle s'efforce de traduire un état émotionnel par définition difficile à rendre en mots, une certaine expérience proche de l'indicible, un vécu purement émotionnel ou existentiel qu'il essaye de fixer d'une certaine manière, et en l’occurrence, pour lui-même plus que pour un public, l'essentiel des chansons de l'album The man who sold the world ayant été écrites pendant une sorte de dépression.
Cet effort de fixation échoue fatalement quelque peu, ce qui peut toujours être rattrapé par la musique, l'interprétation live, le clip, d'autres chansons. C'est cet écart entre la chanson achevée et l'état qui l'a suscitée qui permet à l'auditeur d'y intercaler ses propres états émotionnels, qu'il retrouve, qu'il comprend à travers la chanson. Une chanson vide de sens ne le permet pas, qu'elle soit absurde ou insensée (une souris verte), une chanson univoque ne le permet pas non plus. Comme d'habitude, de Claude François, Ne me quitte pas de Brel, ne sont pas susceptibles d'interprétations diverses. Et pour les ressentir pleinement, il faut avoir vécu pleinement la lassitude ou un baveux désespoir amoureux.
Entre l'insignifiant donc, et l'univoque, il y a Bowie, il a Radiohead, etc. Tout ce que ces groupes ou ces chansons (que peut bien vouloir dire karma police?) demandent, ce n'est qu'une clé qui en éclairerait le sens. Que cette clé vienne de l'oeuvre (texte, musique, album, discographie ; à ce titre là, l'univers signifiant de radiohead est très riche) ou qu'elle vienne de l'auditeur. En matière de pop culture, rentrer par effraction dans une œuvre n'en permet pas moins d'y faire la lumière.
On va tenter les deux approches, jouer au gentil flic-méchant flic ; avant de l'écouter, on va sortir les poings et la violenter à coups d'annuaires. C'est parti pour l'interprétation de la chanson à la voiture-bélier.
On est tous un peu David Bowie quand on traîne sur internet. Internet est un lieu merveilleux où l'on peut se réinventer, et même plutôt s'inventer. On circule dans un univers qui ne distingue plus le présent du passé, le lointain du proche, si bien qu'on y évolue, qu'on s'y rue dans un présent continu, qu'on se choisit et que l'on construit, en décidant des sites, des forums que l'on va habiter, sur lesquels on pourra nous retrouver et par lequel on devient qui on est. Il devient le lieu de l'expérience, celui dans lequel on se forme, dans lequel on se donne forme (avatars, pseudonymes, etc.) Le seul problème, c'est que si internet ne connaît pas la durée, si sur internet le temps n'est qu'addition de pages supplémentaires, accumulation objective de data, nous, nous vivons toujours dans la durée. Nous changeons. Si bien que lorsque l'on retrouve une ancienne page, une ancienne intervention, une ancienne vidéo, qui marque un projet, une émotion, une pensée particulière et ancrée dans le temps, on y sent évidemment une certaine familiarité, mais on y sent aussi une grande distance.
Parce qu'au niveau de la durée, de notre temps vécu, ces moments ont été absorbés, dépassés. Nous sommes une synthèse des moments passés, non une sommation de ces moments. Cette synthèse n'impose pas la conservation, plutôt l'oubli. On ne conserve que du présent. Or là il n'y a pas d'oubli, il y a passé purement passé mais toujours là, il y a passé qui ne passe pas. Une page internet oubliée, un blog oublié, c'est quelque part l'équivalent numérique d'une névrose. C'est surtout l'équivalent d'un fantôme.
Collectivement, dans le traitement de nos mythes, on manque cruellement d'imagination. Le cinéma en reste stupidement au fantôme sous sa forme fantastique. Comme la violation des règles du monde rationnel tel que les sciences le fixent. Et puis, au milieu de tout cela, une apparition (le château d'Otrente), ou une quasi-apparition (le hors-là), et tout la belle stabilité du monde s'effondre, jusqu'à ce que le fantôme soit renvoyé chez lui. Sauf qu'on nous bassine tellement avec ces conneries que le fantôme ne surprend plus, n'étonne plus, qu'il est devenu l'explication la plus immédiate et la plus facilement acceptée. Il n'y a plus de remise en cause de son existence, si bien que tout film de fantôme qui se veut être fantastique-contemporain devient par la force des choses merveilleux-contemporain. C'est-à-dire naïf. Être audacieux, c'est abandonner toute la naïveté de ces enfantillages pour trouver des manières neuves de s'émerveiller de ce qui est, en développant les mythes anciens pour les rendre vraiment contemporains. Être audacieux, c'est faire de la science-fiction. Ni plus. Ni moins. Et comme nous vivons déjà dans le futur, que tout est là à portée de main, faire de la science-fiction, c'est traduire le plus rigoureusement possible ce qui est. Et là dessus, Bowie est plus visionnaire que tout hollywood. Car ce qui est, c'est le fait que les pages internet que l'on créé puis que l'on oublie sont autant de fantômes de nous-mêmes qui hantent le monde, et qui viennent à notre rencontre parfois. Parfois ils posent des problèmes, ce pourquoi tout internaute devrait de temps en temps exorciser ses présents résiduels, les supprimer, les renvoyer dans leur époque et jeter sur eux un voile d'oubli.
Parfois la rencontre est agréable bien que perturbante, et c'est ça qui se passe dans la chanson, le narrateur voit un individu qu'il ne connaît pas et qui pourtant est très familier avec lui, le traite comme un ami, comme un être qui a toujours été là à ses côtés. Et c'est vrai dans un sens, il y a reconnaissance, on se reconnaît dans ces pages, mais il y a une distance, puisque nous n'existions pas encore quand on les a mises en ligne. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'était pas là. Pas encore. C'est pour ça qu'il s'étonne : « je pensais que tu étais déjà mort », t'es un fantôme, t'étais dans le passé, que fais-tu là, comme une fleur, dans mon présent ? Et c'est une affaire sérieuse, il y a une menace insidieuse là-dedans, ce pourquoi le narrateur lui « parle dans les yeux ».
Mais l'autre n'est pas mort, il garde le contrôle, il détermine, du moins le fait-il croire, l'être que le narrateur est devenu, il est son origine et son fondement et comme il est oublié, il peut agir en toute liberté. C'est ce que l'on découvre quand on fouille. Ses vieux poèmes par exemples, ses premières réflexions. On y trouve des images, encore imparfaites, qui ne trouvent leur pleine expression que bien plus tard, parce qu'oubliées elles se cherchent encore en nous, et l'image nouvelle qui vient d'elle-même sous la plume n'est rien d'autre que la première image qui a grandi, s'est affinée. Les réflexions d'un penseur tournent toutes autour des premiers problèmes qu'il a soulevés et jamais résolus. Et on n'est ainsi que le jouet d'un soi passé, qui « se joue du monde ».
Dans le second couplet, le narrateur, perdu dans ses pensées, estomaqué de la découverte, est lui-même congédié comme un fantôme. Il est la conséquence aveugle, l'effet passager d'une cause qui semble avoir plus d'être et de solidité que lui-même : la page internet reste ce qu'elle est de toute éternité (dans ses rêves), continue de vivre sa vie. Le narrateur a un sentiment d'irréalité face à ce qu'il voit, ce n'est pas que tout y est faux ou mensonger (sur internet, personne ne sait que t'es un chien, dit le dessin de presse) ; c'est qu'internet est un charnier, c'est une production industrielle de fantômes, d'êtres pris entre la vie et la mort, qui fait de nous qui les consultons des cadavres. D'où le « regard éteint qu'il jette à la multitude autour de lui », regard absent de celui qui a vu sur trop de pages trop de choses, trop disponibles trop tôt. Qui a échangé avec trop d'utilisateurs qui se confondent tous les uns les autres. Un regard de revenant—revenu de tout—qui n'a que les traces des autres êtres auxquelles se rattacher, semblant d'humanité réduite à une collection d'individus séparés par des écrans, les yeux fixés sur des simulacres, parce que « tous ont crevé de solitude il y a longtemps », ermites de masse abandonnés à leurs déserts, isolés tellement qu'il n'est même plus pertinent de se demander s'ils vivent encore (« who knows ? Not me »). mais est-ce si important ?
Ce cauchemar de Bowie, seule la série Black Mirror l'affronte tel quel. Be right back propose de faire un fantôme à partir de toutes les traces internet laissées par le défunt. Avant, on en était réduit aux pages macabres, mais avec les réseaux sociaux, c'est bizarre, tant que le compte n'est pas fermé, on peut continuer à écrire sur le mur de la personne, endosser son rôle même et le faire vivre pour peu que ses identifiants et mots de passe aient été enregistrés dans le pc ou le téléphone. Une drôle d'histoire comme ça est déjà arrivée. Je crois que c'était une jeune qui envoyait des textos à sa grand-mère défunte, parce que ça la rassurait de pouvoir continuer à lui écrire et à lui raconter sa vie, de se dire que d'une certaine manière, par ce numéro, elle existait encore et la lisait. Sauf qu'un jour elle a eu la peur de sa vie, sa grand-mère lui a répondu, lui disant que tout allait bien et qu'elle la remerciait de ses messages.
1 note
·
View note
Text
Quel problème pose Cantat?
Si j'avais accès à une tribune lue par beaucoup, j'en profiterai pour demander à ceux qui persistent à lyncher Cantat la nature exacte du problème qu'il pose. Cela non parce que je suis fan de l'homme ou de sa musique—la nécessité de le préciser montre déjà la profondeur du gouffre dans lequel on est jeté—mais parce que je suis philosophe et qu'en tant que tel, je ne supporte et ne m'accroche qu'à deux principes dans mes recherches et mes interrogations inquiètes : la clarté d'une part, et l'esprit de conséquence de l'autre.
C'est soucieux de ne m'attacher qu'à eux, et sans a priori, autant que cela soit possible, que je m'apprête à écrire ces quelques menues réflexions, que je m'apprête à proposer quelques possibles réponses à cette question : quel type de problème pose Cantat ?
Admettons ceci : ce problème est soit personnel, soit collectif. Il sera dit collectif non quand il sera montré qu'il touche un certain nombre de personnes, mais qu'il touche toutes les personnes d'un même groupe. Il s'agira alors de déterminer quel est ce groupe, ou le groupe qui doit être privilégié, et quelle est la nature du problème collectif auquel on a affaire. Par exemple, si plusieurs adultes décident de ne plus se vacciner parce qu'ils ne croient pas à l'efficacité des vaccins ou croient à leur dangerosité, c'est un problème personnel, pour eux comme pour leurs proches. Si ces adultes sont nombreux, qu'ils décident pour leurs proches et que par leur faute, des maladies autrefois éradiquées réapparaissent, que la santé de nourrissons, de jeunes enfants et de vieillards et menacée, cela devient un problème collectif de santé publique et donc un problème politique.
Ainsi, pour le cas qui nous occupe, ce n'est pas parce que de nombreuses personnes se sentent concernées, plus de 75 000 signataires de la « pétition non à Bertrand Cantat au festival Papillon de Nuit », que c'est nécessairement un problème collectif. C'est un problème personnel, bien que curieusement massif, s'ils s'indignent pour des motifs personnels, parce que cela les choque ou qu'ils s'imaginent à la place de la famille de la victime. Cela les concerne eux et leur conscience, cela ne concerne ni Cantat, ni son public, ni les organisateurs. Or, dans les débats que l'on voit fleurir un peu partout, il est un argument qui revient souvent et que l'on peut résumer ainsi : « il faut se mettre à la place de la famille, c'est une question de compassion. » On ne peut qu'être d'accord avec cela. Mais qu'est-ce que la compassion ? C'est une vertu morale et non un principe de justice. Avec elle il faut reconnaître d'autres vertus morales, comme la charité. Quelles sont les actions compatissantes ? Lancer des pétitions, lyncher, insulter, cracher au visage d'un homme, c'est n'est pas de la compassion. Soutenir ceux qui agissent ainsi non plus. La compassion est cette vertu naturelle qui nous fait éprouver de la peine pour qui éprouve de la peine, nous empêche de faire souffrir inutilement un être contre lequel on se trouve engagé. La compassion ne pousse et n'autorise aucune action action hostile, ne permet pas non plus de les cautionner. On peut ainsi, on doit même, c'est un devoir d'humanité, éprouver de la compassion pour la famille Trintignant, compatir avec eux, et, par charité, laisser les concerts se faire.
La chose évidemment serait tout autre si ce n'était pas un problème personnel, ou pas qu'un problème personnel, mais un problème collectif. L'engouement pour ces affaires, le fait que je prenne la peine d'écrire plutôt que de hausser les épaules, montrent peut-être que tel est le cas. Mais alors il nous touche en tant que collectif ou touche les êtres qui se sentent impliqués en tant que représentants d'un groupe. Mais quel sera ce groupe ? La famille Trintignant ? Les femmes, victimes désignées des violences conjugales, s'érigeant en classe en lutte sous l'effet de la solidarité ? Les membres des associations et leur public ? Nul n'accepterait de telles restrictions, car cela ruinerait la légitimité de beaucoup de ceux qui participent à ces actions ou prennent position. Mais reconnaissons que ces groupes sont concernés, mais dans tous ces cas, il n'y a qu'une chose à faire pour ceux qui ne sont pas alors concernés : regarder l'affaire se dérouler sans prendre parti. Prendre parti, c'est reconnaître que nous sommes tous concernés. C'est donc en tant que peuple ou nation, ou que sais-je, que nous sommes collectivement concernés.
Mais quel problème nous pose Cantat, collectivement ? Je ne crois pas qu'il faille ici multiplier les hypothèses ; on peut affirmer avec une assez grande certitude que c'est là un problème de justice étant donné qu'il est question partout de jugements et de légitimité. Mais quelle justice, justement ? Quel type de jugement est porté à l'encontre de Cantat, qui justifie qu'il ne puisse plus sortir d'album ni donner de concert ? Car entendons-nous bien. Il n'est pas question, pour ses contempteurs, d'accepter qu'il ait la moindre activité publique et lorsqu'ils déplorent une couverture médiatique trop complaisante, ce ne sont pas tant les magazines qui sont visés que le chanteur lui-même.
Déterminer la nature exacte du jugement qui doit être fait à son encontre est important, car, en fonction de cette nature, les conséquences seront très différentes. Doit-on estimer qu'il nous faut le juger moralement ? ou politiquement ? Et dans ce cas, faut-il le juger à partir des institutions de l'Etat (juridiquement) ou à partir de la société elle-même ? Dans ce dernier cas, quelle sera la nature de la justice envisagée ? Quels en seront les critères ? Qui seront les garants et les exécuteurs de la volonté générale qui se sera exprimée dans le jugement ?
Le jugement moral est un jugement en dignité et en indignité, qui aboutit au blâme et à l'éloge, au soutien et à la réprobation. On a le droit de blâmer Cantat pour son crime et de lui signifier notre réprobation. Nous avons le droit de réprouver son public. Cette réprobation doit-elle aller plus loin ? Doit-on aller jusqu'à attaquer les personnes, les empêcher de vivre, leur nuire ? Il faut bien se garder de verser dans cette confusion qu'autorise l'étymologie. La morale n'est jamais collective. La morale est moins tournée vers l'autre que vers soi-même et n'est jamais qu'un jugement que l'on porte sur ses propres actes et paroles. C'est l'examen de conscience. C'est le tribunal intérieur qui nous fait peser nos décisions et nous les fait parfois regretter. Quand on juge moralement quelqu'un, on n'agit pas physiquement sur lui, mais on en appelle à sa morale, à sa voix intérieur, à son propre jugement. S'il persiste dans ses comportements répréhensibles, on ne peut que, par charité autant que par compassion, se lamenter sur et pour lui, parce que, manifestement, « il ne sait pas ce qu'il fait ». Autant dire que le jugement moral n'est porté que par des êtres optimistes qui croient en la bonté de l'homme, en sa capacité à se racheter, qui croient, avec Jésus et Socrate, que « nul ne fait le mal volontairement ». Mais ce n'est pas cela que l'on voit à l'oeuvre. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est au jugement de mœurs. Ce jugement de mœurs rappelle à l'ordre brutalement ceux qui y contreviennent, parce que ce qui compte n'est pas la conversion intérieur vers ce qui est juste mais l'homogénéisation de la société par la contrainte. Cette contrainte est moins tournée vers l'autre que vers soi ; le but est de se rassurer en écartant, en rabaissant, en détruisant si possible, tout ce qui menace. Il faut aussi faire attention au fait que les mœurs changent et qu'étant instables et changeantes, elles nous contraignent à agir et juger non en raison de principes fortement ancrés en nous, mais en fonction d'une opinion publique douteuse que l'on ne peut ni situer, ni raisonner. Quel semble être le principe selon lequel ces mœurs jugent ? Que disent-elles ? Qu'un assassin ne peut plus vivre. Qu'il doit porter sur lui la trace de son infamie, qui le suivra partout et indiquera à tous ce qu'il est, ce qu'il a fait. Cela n'est pas le fait d'une société morale, mais d'une société puritaine aveugle et hypocrite. Ce à quoi on assiste, c'est à une réécriture de The Scarlet Letter, où l'on monte en épingle les crimes des autres pour mieux effacer les siens. Cela est hypocrite et contre-productif : on parlerait bien moins de Cantat, il retomberait vite dans un relatif oubli si on cessait dès maintenant ces controverses.
Est-ce une question de justice politique ? On dira alors que la justice à tranché déjà, que le jugement a eu lieu, que la sanction est tombée, que la peine a été purgée et donc, puisqu'un homme ne peut pas être jugé deux fois pour un même crime. La question est donc réglée. Mais c'est bel et bien socialement qu'il est jugé, le jugement politique étant contesté comme n'étant pas assez fort, comme n'étant pas proportionné au crime. Mais un tel jugement est un jugement culturel, un jugement de mœurs et en a les défauts. Mais plus que la nature du jugement, c'est peut-être aussi son principe qui doit être critiqué. Quelle est cette justice qui, sans pouvoir se prévaloir d'aucune autorité, se permet de juger non pas une fois pour toute, mais toutes les fois qu'elle l'estime nécessaire, une personne qui ne peut se défendre d'aucune manière, se constituant ainsi comme étant l'exact opposé de l'institution de la justice, qui elle juge une fois pour tout un acte suivant des procédures et selon des règles qui sont connues à l'avance et dont on peut user pour se défendre. Un tribunal qui juge en permanence un homme qui ne peut se défendre d'aucune manière, cela fait soit penser aux cauchemars de Kafka, soit au fonctionnement d'une société totalitaire. On me rétorquera que ce n'est là que justice, qu'elle est morte et lui en vie, que sa famille à elle souffre et que lui pavane. Mais là encore, on ne peut qu'être d'accord pour déplorer, sur un mode moral, ce fait, mais dès qu'il s'agit d'instruire culturellement à partir de règles de vie non écrites, à partir de mœurs changeantes, face auxquelles il n'y a pas de défense possible, il faut s'y refuser, tant pour des question morales que politiques, tant par sentiment d'humanité que par raison attachée aux lois des principes et des conséquences. Car si cela est ainsi pour Cantat, il faut que ça le soit pour tous. Or, sommes-nous tous bien assurés de ne jamais tuer personne, de ne jamais ôter aucune vie, de ne jamais provoquer d'accident de la route, de ne jamais donner de coup malheureux en se battant contre quelqu'un, de ne jamais avoir un geste maladroit ? On dira que dans ces cas il n'y a pas volonté de tuer, mais le résultat sera le même. Et pour celui qui passe devant la justice, quel que soit son crime ou son délit, ne devra-t-il pas, lui aussi, en chaque occasion, se voir renvoyer à son acte passé ? Quel type de société est-ce là ? On dira qu'il n'est question que de Cantat. C'est bien là que le bât blesse : s'il n'est question que de lui, c'est donc un problème personnel, c'est parce qu'il est antipathique aux yeux de 75000 personnes, or il est plus qu'odieux de harceler quelqu'un pour cette raison. Si au contraire c'est une question de principe, il faut que ce que subit Cantat soit subit par tous les autres. Nous savons où mène cette situation : aux Etats-Unis, ceux qui ont été reconnus de pédophilie doivent se tenir éloignés des écoles. Dans certaines villes où il y en a beaucoup, cela leur laisse peu d'espace pour vivre sans risquer la prison. C'est ainsi que certains se retrouvent à plusieurs à vivre sous un pont ou sur un terrain vague, seul lieu réglementaire où ils peuvent séjourner. C'est ainsi aussi que des sites donnent accès au nom et à l'adresse de personnes jugées pour pédophilie ou autre, si bien que les gens peuvent savoir s'ils vivent près d'un tel individu et le pousser, par des pratiques similaires à celles que l'on voit à l'oeuvre en ce moment, à déménager dans l'espoir d'être tranquille. C'est là une justice sociale puritaine, et par justice, il faut entendre non la vertu morale, la justicia, mais l'impératif qui s'impose avec force, le jussum.
Ce Jussum est assumé par des personnes certaines d'elles-mêmes, de ce qui est bon et juste, de ce qui doit être dit et fait et de ce qui doit advenir de Cantat. Non en raison de principes. Mais parce que c'est ainsi, parce qu'elles ont avec elles toute l'autorité des mœurs, et, dirons-nous, des bonnes mœurs. Aux yeux de telles personnes, j'imagine que ceux qui défendent Cantat sont aussi coupables que lui, que ceux qui ne se mouillent pas sont des lâches. Je les revois à Responsabilité et Jugement, livre d'Hannah Arendt, dans lequel elle affirme que le problème moral que posait le nazisme ne concernait pas les crimes mais la vitesse et l'aisance avec laquelle l'opinion publique, les penseurs, les tenants de la morale, les membres des institutions et de la presse s'étaient convertis aux vues de Hitler. Le problème, c'est l'absence de recul et de jugement des hommes sur leurs actes et sur les actes qu'on leur demandait de cautionner. Évoquant ce problème, elle n'hésite pas à parler d'effondrement moral. Voilà ce qu'elle dit : « l'effondrement moral total de la société respectable sous le régime de Hitler peut nous enseigner qu'en de telles circonstances, ceux qui chérissent les valeurs et tiennent fermement aux normes et aux standards moraux ne sont pas fiables : nous savons désormais que les normes et les standards moraux peuvent changer en une nuit, et qu'il ne restera plus que la simple habitude de tenir fermement à quelque chose. Bien plus fiables sont ceux qui doutent et sont sceptiques, non parce que le scepticisme est bon ou le doute salutaire, mais parce qu'ils servent à examiner les choses et à se former un avis. »
Ce scepticisme trace une ligne de partage, selon elle, entre « les meilleurs de tous », qui savent que juger, c'est refuser de participer au crime, et les autres, qui s'imaginent que juger, c'est juger et traquer les crimes des autres, attitude qui porte en elle déjà tous les totalitarismes.
J'ai beau jeu, je sais, de finir sur cette note qui fait de moi un des « meilleurs de tous », mais je ne demande pas des fleurs, je demande à être rejoint dans cette catégorie pour examiner la chose. Quel est la nature du problème que pose Cantat et le fait qu'il donne des concerts ?
0 notes
Text
Il y a une différence entre expliquer et exploiter une citation ou une œuvre. Entre interpréter et utiliser un texte, comme le signale Umberto Eco. Je suis tombé sur un exemple assez ancien de cela. En 2013, Anne Sinclair, dans son blog du Huffingtonpost, donnait une formule de Pascal comme titre à une de ses notes.
« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà. » Voilà ce qu'elle dit en ouverture :
« Cette pensée de Pascal si connue qu'elle en est devenue un proverbe, signifie simplement que ce qui vaut pour un peuple, ne vaut pas nécessairement pour un autre. La relativité s'impose dans le constat. La géographie, la culture, les mentalités, la politique, le climat, tout se mêle pour faire qu'un symptôme, une crise, un état d'esprit, ne concernent vraiment que le pays qui les subit.
Je l'ai vérifié concrètement cette semaine, "au-delà des Pyrénées" justement, en faisant un court séjour à Madrid. »
À ceci près que ce qui est célèbre n'en est pas pour autant connu et que dès qu'il est question de Pascal, parler de « simplicité » est nécessairement et immédiatement douteux. Si Pascal ne disait que cela, que la vérité est relative, on n'aurait pas besoin de lui, la vulgate ayant accepté et imposé ce fait depuis bien longtemps. Car ce qui est conclusion pour Anne Sinclair, vérité établie (c'est déjà un problème, nous y reviendrons), prémisse certaine pour de nouveaux développements, est un point de départ pour la réflexion de Pascal. La vérité n'est pas solidement établie, la justice non plus, puisque ce qui est juste dans un pays ne l'est pas dans un autre. Autant dire qu'aucune législation n'est juste, qu'aucun peuple ne détient la vérité. Pourtant cette vérité existe puisqu'il y a un Dieu unique, siège et origine de toute justice, de toute vérité. Et c'est là que c'est épineux. Car si la vérité existe, qui la détiendra, si ce n'est moi, mon peuple ? Si un autre la détenait et qu'elle était la vérité, assurément on l'aurait acceptée, reconnue immédiatement comme vérité, me cela n'arrive pas. N'est pas arrivé. Est-ce à dire que mon peuple la détient ? Mais si les autres la refusent, c'est qu'ils refusent Dieu. Il faut donc les détruire ou les évangéliser de force, puisqu'ils refusent la Parole. Pareil pour la justice, ne serait-il pas injuste d'imposer la justice, fût-elle divine, au peuple qui ne la reconnaît pas comme juste ? Si cela était juste, Dieu n'aurait-il pas agit ainsi, nous imposant une justice que l'on ne peut qu'accepter ? N'est-il pas injuste d'imposer une vérité à qui ne la reconnaît pas, et le fait qu'elle ne soit pas reconnue n'est-elle pas la preuve que nous ne sommes pas assez assurés que c'est bien là la vérité ? Qu'il nous manque un critère, de reconnaissance, une preuve ?
Ainsi il me faut reconnaître que mon pays n'est pas plus juste, ni mon peuple plus sage, que le plus sauvage, le plus barbare, le plus primitif de tous les peuples. Je crois que ce sont les allemands, mais je suis pas sûr. Ce n'est pas que nous sommes tous aussi sages et savants, c'est que nous ne le sommes pas du tout. Pascal, son but, n'est pas de relativiser, c'est d'humilier. Rien de simple là dedans. Que faire, en attendant : accepter les lois et les coutumes de mon pays, comme le disait Descartes, en attendant la certitude. Pour Descartes, c'est un principe prudent, cela permet de vivre tranquillement, pour Pascal, c'est une question de devoir. La loi ne repose sur rien d'autre que sur sa propre autorité, que sur le fait qu'elle impose et il est bon pour l'homme d'obéir à la loi, fût-elle injuste, en attendant d'obéir à la bonne. N'oublions pas qu'à l'époque, la loi, ce n'est pas le parlement, une machinerie de gestion, c'est le roi et qu'elle se présente sous la forme d'une puissance impérative.
Mais il y a quelque-chose de gênant, dans cette introduction d'Anne Sinclair, dans cette idée lâchée hâtivement d'un « symptôme ». C'est un mot très à la mode on ne s'en rend pas très bien compte.
Le symptôme tient à la maladie. Utilisé dans l'abstrait, Comme ici, comme dans les Pathologies politiques d'Alain Duhamel, il ne signifie rien, n'est qu'un cache-misère employé pour ne pas montrer que l'on ne pense pas réellement à ce que l'on écrit. Mais il y a un usage plus pensé, qui renvoie à tout un courant de la philosophie : la philosophie sociale, mais on peut en fixer diverses origines plus ou moins anciennes. Philosophiquement, il faut certainement remonter à Platon, pour qui la société est un corps social et l'injustice une maladie, une pathologie due à un dérèglement dans les humeurs, pour employer des métaphores hypocratiques. C'est parce que les hommes, poussés par leurs propres humeurs déréglées à sortir de leur rôle, que la société subit l'injustice comme un échauffement du corps social qui le met en danger. La justice, c'est que chacun reste à sa place en fonction de son statut, de son rôle, de ses qualités. Il faut rétablir les équilibres et les hiérarchies naturelles pour redonner sa santé à la société. Mais pour ce qui est des incarnations technocratiques, de l'usage de ces notions par des discours qui accompagnent et guident le pouvoir tel qu'il s'exerce, il faut peut-être remonter au tournant du XVIIIe/XIXe siècle, avec ce Foucault nous présente comme étant la « pathologie de la conduite criminelle » :
« Désormais – en vertu des principes de fonctionnement du pouvoir pénal, en vertu non pas d’une nouvelle théorie du droit, d’une nouvelle idéologie, mais des règles intrinsèques de l’économie du pouvoir de punir– on ne punira, bien sûr, qu’au nom de la loi, en fonction de l’évidence manifestée à tous du crime, mais on punira des individus qui seront désormais toujours référés à l’horizon
virtuel de la maladie, des individus qui seront jugés en tant que criminels, mais jaugés, appréciés, mesurés en termes de normal et de pathologique. La question de l’illégal et la question de l’anormal, ou encore celle du criminel et celle du pathologique, sont donc liées maintenant et non pas à partir d’une nouvelle idéologie relevant ou non d’un appareil d’État, mais en fonction d’une technologie caractérisant les nouvelles règles de l’économie du pouvoir de punir. »
Cette conception de pathologies sociales, se manifestant dans des symptômes divers, est un discours familier de la sociologie et de la philosophie sociale. Si au XIXe siècle Durkheim défend si vivement une interprétation sociale du suicide, c'est parce que tout au long du XIXe siècle, la psychiatrie, née des besoins de la justice, enquête avec avidité sur les causes du suicide et s'efforce de réduire le suicide à un symptôme d'aliénation, de maladie mentale. Pour Durkheim au contraire, il est surtout question de pathologie sociale, tenant à « un état de gêne intime de la société » dû, on le comprend à demi-mots, à la progression du capitalisme et à la destruction qu'il entraîne des anciens liens et des anciennes solidarités. On se souvient aussi, plus récemment, de Vernant demandant, à propos de Onfray, de quoi il est le symptôme ; et la même idée exprimée autrement, par Alain Badiou, quand il demandait de quoi Sarkozy était le nom, lançant ainsi une petite mode éditoriale. Mais cette idée de symptôme pose un problème énorme. Car en médecine, nous savons bien que la maladie est due à un trouble, à un agent pathogène, maladie qui se manifeste par des symptômes qui sans être la maladie, font signe vers elle. Le médecin, recueillant par entretient et observations l'ensemble des symptômes, a tous les indices lui permettant d'identifier la maladie, le trouble, l'infection, etc, qui cause la gêne et menace le patient. Mais si cela est possible, c'est parce que nous savons quel est l'état normal, sain, de l'organisme, ce qui fournit une claire idée de l'état qui doit être le sien, de l'instant où l'on bascule dans la pathologie.
Mais il n'en va pas de même pour la société et ici, c'est bien plus souvent le médecin qui produit la maladie, en décidant de ce que doit être l'état de santé sociale. Parfois, de manière qui semble digne de foi (l'état dégradé du travailleurs selon Marx), parfois de manière plus douteuse (quand Vernant fait d'un philosophe peu rigoureux mais célèbre un symptôme d'une maladie qu'il ne nomme pas). Car à ce compte-là, tout peut être symptôme, tout état ou fait peut être considéré comme pathologique si on ne met pas des bornes à l'effort d'interprétation. Mais quelles bornes ? Selon quelles normes ? Cela est une interrogation labyrinthique qu'Anne Sinclair, certainement, n'a pas même effleurée.
0 notes
Text
Only god forgives (1) narration
Présentation
Prenons des exemples de films, analysons les autant que le format le permet. Il nous faudra suivre la construction de l'intrigue, dire quelques mots de la matière de ces films, éprouver la cohésion entre elles, puis tenter, à partir de là, une interprétation du film. On s'efforcera ici d'aborder trois films : un film mystère, un film artistique, un film d'industrie, comme j'ai proposé de les appeler. Autrement dit, des films qui s'efforcent de créer une surprise, par l'intrigue en suspens ou par la technique, puis un film qui se contente des cadres qui sont ceux de son genre.
Only god forgives, film de Nicholas Winding Refn sorti en 2013, nous servira ici de modèle de film mystère. Non pas qu'il propose un twist final à la fin, mais tout, dans l'ambiance, l'absence de dialogue, concourt à faire de ce film une énigme. Sa signification, l'identité du policier, qui n'est jamais nommé (Chang), le sens à donner au film, aux scènes et aux personnages, tout cela reste profondément mystérieux.
Le film a été fraîchement reçu. Il a des notes un peu en dessous de la moyenne sur l'ensemble des sites de notation de films, ce qui à faire dire qu'il est quelque peu boudé. Pas seulement parce qu'il aurait été mal compris, mais son rythme lent, son laconisme, le contraste entre lui et Drive, qui l'a précédé, sont autant d'obstacles à un film que beaucoup espéraient accessible à une large audience. Il faut dire que le synopsis fait attendre un film d'action classique (la drogue, le meurtre, l'opposition à la police, les arts martiaux) et seul la présence de Refn à la réalisation incite à plus de prudence. Le titre d'ailleurs est le principal mystère, il nous faudra pouvoir en donner le sens.
Structure et narration
Le film, d'une heure et demie environ, se divise en trois tiers d'environ 30 minutes, séparés par des intermèdes musicaux dans lesquels le policier chante des bluettes romantiques. Le premier, classiquement, installe la situation : la rivalité entre les frères, leur commerce, l'opposition avec la police. Il s'achève avec l'arrivée de la mère de Julian. Le deuxième tiers est centré sur l'opposition entre lui et sa mère d'une part, entre cette dernière et le policier d'autre part. Elle cherche à faire tuer ce dernier, ce qui, au terme d'une enquête rapide, l'amène à se tourner vers Julian et sa mère. Le dernier tiers est celui des confrontations et de la résolution finale. Julian affronte par deux fois le policier et s'oppose à sa mère alors que jusqu'alors, il était soumis.
Générique.
Le générique est très stylisé, montrant simplement, sur un fond noir, le sabre de Chang glisser lentement de droite à gauche, éclairé en rouge orange. Des écritures jaunes apparaissant en cambodgien. La musique est angoissante.
Premier tiers : mise en place de l'intrigue.
Les 30 premières minutes installent l'intrigue et les différents personnages. D'abord les deux frères, le policier, puis la mère. Ces présentations sont l'occasion de montrer les personnages secondaires qui serviront de liens entre eux pendant les deux premiers tiers du film : le père de la prostituée assassinée, le jeune boxeur.
Julian :il apparaît comme un « homme de l'ombre ». La première fois qu'on le voit, il est plongé dans une telle obscurité qu'on ne voit pas son visage, il est seul. Il nous faudra d'ailleurs attendre longtemps avant d'apprendre son prénom. Arrivé dans la salle de boxe, il se tient à l'écart, dans l'ombre toujours, regardant ce qui se passe, que ce soit le match ou le trafic de drogue orchestré par un homme auquel il a fait signe. Il semble détaché, loin de tout, ce n'est jamais lui qui décide, qui parle, qui agit.
Billy : Billy au contraire agit. Il manie l'argent, il gère le trafic, il semble particulièrement préoccupé par le sexe. Lorsqu'il paye le jeune boxeur, il lui conseille de ne pas « tout claquer dans le même bordel » et va ensuite lui-même voir des prostituées, ce qu'il semble appeler son « faire un tour en enfer ». Il paraît être tout le contraire de Julian, modèle absolu de sobriété : il boit trop, il est violent et impulsif, il est corrompu et n'en fait qu'à sa tête. Ce n'est pas une simple prostituée qu'il veut, il en veut une mineure. Il va même jusqu'à demander au premier tenancier de bordel de lui prostituer sa propre fille. Face au refus de ce dernier, il se met à frapper tout le monde. Il marche ensuite, usé semble-t-il d'avoir tabassé les prostituées, et s'arrête devant un deuxième bordel, devant lequel attend une jeune fille.
Chang : Après que Billy soit monté, on voit l'entrée du bordel, une voiture de police garée devant. On voit un homme sorti de nulle part qui marche dans la rue et se dirige vers le bordel. On comprend qu'il est un policier quand il s'arrête longuement devant la voiture, avant de monter les escaliers rejoindre la scène de crime. Lorsque le père arrive identifier sa fille, Chang l'invite à rester. À se rattraper et faire ce qu'il veut. Il découvre en rentrant à nouveau dans la chambre que le père a tué Billy en lui éclatant le crane. Le père de la prostituée est amené dans un terrain vague et semble subir une sorte de procès sommaire. Il plaide son cas devant Chang qui lui laisse la vie sauve pour « qu'il n'oublie pas ses trois autres filles », afin, donc, qu'il ne les prostitue pas à leur tour. Chang, néanmoins, à l'aide d'un sabre qu'il sort magiquement de son dos, lui tranche un bras.
May et première scène onirique : Julian est assis sur une chaise, une jeune femme brune arrive et lui attache les mains. Elle s'assoit au coin du lit, devant lui, puis se masturbe. La scène semble très ritualisée. Une musique mystérieuse monte, la femme est montrée debout, Julian sort de la pièce et marche dans un couloir tapissé de motifs répétés. Il semble marcher dans un labyrinthe. Il s'arrête devant une porte, tend le bras dans l'obscurité de cette seconde pièce. C'est alors qu'on voit le policier lui trancher le bras d'un geste vif. Ce coup coïncide avec l'orgasme de May, toujours assise sur le lit devant Julian immobile sur sa chaise, mais visiblement troublé. La scène s'arrête quand on vient lui apprendre que son frère est mort.
Intermède : On assiste alors à la première scène de karaoké. Chang, sur la scène d'un cabaret aux murs bleus et au plafond constellé de lanternes rouges, chante une chanson romantique. « Je n'oublie pas. C'est éternel comme la lune accrochée au ciel. Je n'oublie pas la saveur de notre amour. Je m'en souviendrai jusqu'à la fin. » « je n'oublie pas malgré les mois, les années. » « je te demande seulement de ne pas m'oublier ».
Crystal : Une femme blonde, habillée en rose, arrive en pleine après-midi à l'accueil d'un hôtel luxueux. Elle se montre inhumaine et insultante avec l'hôtesse quand celle-ci lui dit qu'elle ne peut accéder encore à sa chambre. Elle nous apprend qu'elle est la mère de Billy, dont elle vient récupérer le corps, et qu'elle vient des Etats-Unis. Dans sa chambre, elle se coule un bain avant de se diriger sur le toit terrasse, portant son regard sur la ville.
L'assassin de Billy : par le jeu du montage, on a l'impression que Crystal regarde de loin son fils, celui-ci attend dans un quartier pauvre, adossé à un mur. Le père de la prostituée arrive, conduit par une autre de ses filles, le bras dans un bandage. Lorsqu'il rentre chez lui, Julian et ses hommes le suivent et, le menaçant d'une arme, l'interrogent. Le père raconte alors ce qui s'est passé, mais nous n'entendons pas, une musique oppressante monte, ponctuée de flashs sur Chang et son sabre. Nous voyons alors Chang rentrer chez lui et passer un moment avec sa fille. Ils semblent avoir une discussion sur le comportement de ses poupées. Chang lui demande : « comment savoir qu'elle ne fera plus de bêtise ? » Sa fille lui répond : « en étant sage avec elle ».
Julian et Crystal : Julian se lave les mains dans des toilettes éclairées en bleu. Très vite, du sang coule du robinet : il a du sang sur les mains. Il se retourne et voit Chang. Il se retrouve alors dans le labyrinthe, guidé devant la même porte, mais il prend peur et fuit. Dans la chambre où May s'était masturbée pour lui, il retrouve sa mère. Celle-ci ne comprend pas pourquoi Julian n'a toujours rien fait contre l'assassin de son frère, le traite en moins que rien, est aussi autoritaire avec lui qu'avec l'hôtesse et décide de prendre l'affaire en main, de venger elle-même l'assassin de son fils.
Deuxième tiers : confrontations
Vengeance 1 : Le jeune boxeur du début du film tue l'assassin de Billy. Un homme du club le paye et lui interdit de revenir. Cela est rapporté à Crystal, qui apprend alors l'implication de Chang, qu'elle envisage immédiatement de tuer.
Diverses facettes de Julian : Julian, assis sur un canapé, regarde May, debout dans un coin de la pièce derrière un rideau de perles. Il s'imagine s'approcher d'elle, glisser sa main à travers le rideau de perles pour atteindre ses cuisses. Mais un homme rit à l'autre bout de la pièce, le sortant de sa rêverie. Il se lève alors, lui éclate un verre au visage et le traîne par la mâchoire jusqu'à la sortie.
Julian et Chang : Julian écoute, stressé, la mère du boxeur pleurer sa disparition, accuser un homme parlant anglais. Il se tourne alors vers son acolyte, comme pour l'accuser. Cette scène est interrompue quand on lui annonce la venue de policiers. Julian va les voir, il apprend alors la mort de l'assassin de son frère et rencontre pour la première fois Chang. Celui-ci va voir les jeunes boxeurs, qui se réunissent devant lui pour le saluer avec un très grand respect. Lorsque Chang repart, il regarde longuement Julian avant de dire « ce n'est pas lui » avant de passer les portes. Julian le suit mais le perd très étrangement dans la ville.
Vengeance 2 : Crystal engage un occidental pour tuer Chang.
Crystal et May : Julian offre une robe à May et lui demande si elle voudrait rencontrer sa mère. I veut qu'ils ressemblent à un « vrai couple ». Ils arrivent au restaurant, la mère les attend, seule à table, dans une robe aux motifs animaliers. Elle se montre d'ailleurs particulièrement féroce écrasant, humiliant ses deux invités, commandant même pour eux.
« bon, éclairez moi, May, que faites vous dans la vie ?
Je suis hôtesse d'accueil.
Et combien de queues à la fois vous accueillez en même temps dans votre charmante boîte à foutre ? Vous en pensez quoi de son travail […] il est dealer. C'est avec ça qu'il peut se payer votre chatte ».
Elle s'attache ensuite à humilier Julian en évoquant le souvenir de Billy. Selon elle, Julian déteste ou est jaloux de Billy, qui lui était un homme et dont la virilité était évidente et fière. Selon elle, Julian se réjouit de la mort de Billy et estime qu'il a mérité ce qui lui est arrivé. Au sortir du restaurant, Julian s'énerve quand May lui demande pourquoi il se laisse écraser de la sorte. Il répond que c'est parce que c'est sa mère et hurle ensuite pour récupérer la robe qu'il lui a donné. Elle l'enlève et la lui tend, mais il ne la prend pas.
Vengeance 3 : L'homme que Crystal a engagé paye des tueurs qui partent à moto assassiner Chang. Mais celui-ci, qui dîne avec des collègues, semble comprendre bien à l'avance ce qui va arriver et parvient à échapper aux assassins. Il court après la fusillade après l'un d'eux, il n'a aucune peine à le suivre, il va même l'attendre au coin d'une ruelle, certain du chemin qu'il empruntera. Il le frappe avec un wok au moment où il passe à son niveau.
Enquête : Chang a interrogé l'assassin qu'il a attrapé, ce dernier l'a conduit dans une sorte de hangar où un homme nourrit un jeune enfant. L'assassin le désigne comme son commanditaire. Quand Chang lui demande pourquoi il a fait ça, il se lève et lui rapporte un bout de papier. Il se dit prêt à assumer les conséquences de son acte, demande juste à ce que son fils soit épargné. Rien ne nous indique que cet homme sera tué, mais l'assassin, qui, lui, implore pour sa vie, sera tué sur place d'un coup de sabre à travers le torse. Il se retrouve ensuite dans un club kitschissime où l'homme engagé par Crystal écoute une chanteuse. Chang le cuisinera pour savoir qui l'a engagé, mais il ne dira rien, juste qu'il a tué son fils et qu'elle a juré de le venger. Il le torture, lui plantant des piques dans les bras, les jambes, lui crevant les yeux et les tympans.
Intermède 2 : Chang chante dans son club mais une musique angoissante masque sa voix. Crystal, Julian et May sont présents, on ne sait pas si la scène est une scène de rêve ou si elle est vraie.
Troisième tiers : résolutions
deux combats : À la fin de l'intermède, Julian et May sortent du club à la rencontre de policiers. L'un d'eux demande à julian : « Sais-tu qui il est ? » Julian, sans répondre, se dirige vers Chang et lui propose un combat. Julian boxe contre Chang qui, sans effort, a le dessus. Le montage semble faire un parallèle entre Chang et la statue dorée du club représentant un boxeur en position. Quand Crystal arrive à son tour dans le club, elle fait face à Chang mais s'enfuie comme terrifiée. À la fin du combat, Chang, doublement victorieux repart. May également quitte le lieu et Julian par la même occasion.
Julian et Crystal : Crystal est terrifiée. Elle sait que Chang va la tuer, elle implore Julian de la protéger. On apprend alors que Julian a déjà, à sa demande, tué son propre père et que c'est pour cette raison qu'il s'est exilé à Bangkok.
« J'ai merdé. J'ai voulu faire honneur à Billy. Et ça va me coûter cher. Maintenant c'est à moi qu'il va s'en prendre et j'ai plus personne pour me protéger. Je sais qu'après ton père et j'ai dit que ne jamais, jamais je te le redemanderai mais juste une fois s'il te plaît, règle le problème pour moi, empêche les de me faire du mal et après ça on s'en va, on rentre ensemble, je serai ta mère comme je l'étais avant. »
Chez Chang : Chang part de chez lui, installe un policier devant la maison pour qu'il surveille et protège sa fille. Julian le tue et attend à l'intérieur avec un acolyte. Ce dernier revêt un visage de mort pour attendre Chang, il veut, conformément aux ordres de Crystal, tuer tout le monde. Julian, lui, ne veut tuer que le policier.
À l'hôtel : Crystal semble écrasée, petite dans le grand canapé, face à Chang. Elle dit qu'elle va partir, reprendre l'avion et s'efforce de rejeter toute la faute sur Julian, elle paraît alors grandir, reprendre consistance et confiance en elle. Selon elle, Julian est un tigre, il est féroce, c'est le pire et le plus violent des fils. « Il n'y a pas plus dangereux que mon fils ». Chang sort son sabre et le plante dans la gorge de Crystal, qu'il laisse pour morte.
Chez Chang : La fille de Chang rentre avec sa babysitter, que l'acolyte tue froidement. Mais lorsqu'il s'apprête à tuer la petite, Julian lui tire dans le dos à plusieurs reprises et le tue. Il repart ensuite, emportant un sabre.
À l'hôtel : Julian entre dans la suite, fait face au cadavre de sa mère. Il lui ouvre le ventre à la pointe du sabre puis, à genoux, glisse sa main dans la plaie, ce qui lui évoque le souvenir de May et la scène pendant laquelle il la regardait à travers le rideau de perles. Chang arrive, ils n'échangent pas un mot.
Jugement : Julian, au milieu d'une forêt, ferme les poings et tend les bras. Chang les tranche d'un coup sec. On entend alors s'élever une musique enfantine. Chang est sur scène, chante pour la dernière fois une chanson romantique : « tu es comme un rêve dans mon cœur, juste un rêve inaccessible comme une étoile dans le ciel immense il est impossible de te saisir. Comme une fleur un symbole d'espoir l'expression d'un rêve »
L'histoire, résumée ainsi, est simple et ne se déroule d'ailleurs que sur quelques jours. C'est un récit de vengeances entrecroisées, avec une enquête au milieu, rapidement menée. Un homme tue une prostituée. Le père de cette dernière assassine l'homme qui a tué sa fille, avec l'aide de la police. Les proches du premier tueur décident de le venger, tuent le père assassin et envisagent de tuer le policier qui a laissé faire. Ils ne parviennent pas à le tuer, celui-ci remonte la piste jusqu'aux commanditaires et tue celle qui voulait sa mort. Mais si l'histoire est simple, tout ce qui entoure l'histoire baigne dans un mystère opaque. Les plans et la musique, les intermèdes et certaines scènes oniriques embrouillent la lecture que l'on peut faire du film. Ce qui fait obstacle, ce n'est pas l'histoire, donc, mais la narration, la manière dont cette histoire est raconté et les vides qu'elle laisse volontairement, obligeant le spectateur à spéculer sur le film, les personnages, les scènes, pour venir combler les blancs de l'histoire.
Ce que nous ferons, justement, d'abord en analysant la matière du film : enchaînement des plans dans quelques séquences, lié à la musique et aux dialogues. Ensuite en abordant les symboliques générales liées aux personnages et à leurs relations. Enfin en proposant une interprétation du film.
4 notes
·
View notes
Text
Spoiler Alert ! (4) Atomic bomb, Blade Runner, Mulholland Drive
Prenons quelques films et essayons de donner des exemples. D'abord à ces divers types de twists, ensuite à ce plaisir particulier que l'on peut avoir à revoir un film.
Notons que les retournements de situation susceptibles d'être spoilés dans un film sont :
1_la perturbation de la situation initiale.
2_une perturbation qui fait passer d'une situation délicate à une situation désespérée
3_la perturbation qui rétablit une situation d'équilibre.
4_la révélation, finale ou non, qui modifie intégralement notre lecture du film ou d'un personnage.
Mais plusieurs remarques s'imposent d'emblée.
D'abord, la perturbation de la situation initiale est généralement connue par avance et attendue. Il est rare que les surprises interviennent à ce niveau là. Souvent, la fin est connue d'avance, on ignore seulement comment on y parviendra. Donc la perturbation qui rétablit une situation d'équilibre, en toute logique, est elle aussi assez peu surprenante. Reste surtout le twist final (4) et les perturbations dramatiques (2). Ces perturbations dramatiques devenant d'ailleurs un code dans les films d'actions construits en quatre chapitres, le troisième chapitre étant une phase de ralentissement dans la narration à l'occasion de la chute ou de la défaite du personnage, peu avant que la situation ne se rétablisse dans un dernier feu d'artifice.
Ensuite, il faudrait ajouter également que dans l'immense somme des récits fictifs, tous ne subissent pas le spoil de la même manière, certains même semble le supporter sans trop d'effort. Il en va ainsi des films de genre ; le genre correspond à un ensemble de codes qu'il est difficile de transgresser, qu'il faut respecter un minimum et qui imposent autant de situations et de structures types. Ainsi des comédies romantiques. La structure est connue : un personnage en rencontre un autre, l'aime tout de suite, bien qu'il soit déjà pris dans une relation. Il affrontent un épreuve, se heurtent sur un obstacle qui les sépare. Le personnage peut même vouloir couper tous les ponts avec l'autre, mais à la fin, à la lumière d'une révélation soudaine, il court vers l'autre personnage et plaque tout pour se mettre avec, filer le parfait amour, puisqu'ils sont faits l'un pour l'autre. On sait ainsi exactement à quoi s'attendre et c'est ce qui est si réconfortant et agréable avec les comédies romantiques : elles ne nous bousculent jamais.
Ainsi, le plus souvent, le film vu est connu d'avance dans son rythme, sa structure, ses codes, ses péripéties initiales, son aboutissement. Sauf, bien entendu, dans le cas d'un twist final, mais alors, le film risque fort de ne pas survivre dans la durée, quand il a la chance de ne pas avoir un retournement surfait. Ce qui est le cas dans Atomic Blonde. À la fin, le spectateur apprend que le personnage principal, envoyé à Berlin Est à la recherche d'un agent double … est en fait l'agent double qu'elle doit arrêter. Son enquête était en fait une démarche menée afin de se couvrir. Sauf que rien ne permet, dans le film, de déterminer cela ; c'est un deus ex machina qui ne sauve rien, ne surprend pas plus que cela, vu qu'aucun autre personnage n'est désigné réellement comme étant cet agent double. Bref, ce retournement, comme ce film, est un fiasco qui a le mérite de montrer que la nostalgie des années 80 ne permet pas de tout justifier. Une seule séquence à sauver, l'exfiltration ratée de l'indic, dans l'immeuble d'abord : une scène de combats sans fin, avec une caméra qui tournoie et la poursuite en voiture qui suit, séquence qui emprunte énormément au jeu vidéo ; ce qui la sauve et la distingue absolument. Mais, là encore, il suffit de voir le 6e sens, où ce coup-ci le twist est efficace, pour voir que cela ne suffit pas à en faire un film que l'on a plaisir à revoir. C'est que tout concourt à la fin sans dévier le moins du monde de cet objectif.
Prenons des films, avec ou sans twist, qui se regardent encore et encore sans aucun souci. On peut appeler ces films des classiques, non pas parce qu'ils seraient conformes à une manière classique de faire, mais parce que leur connaissance et leur appréciation est collective, si ce n'est commune. On peut prendre en exemple le Rocky Horror Picture Show. Ceux qui adorent ce film le connaissent par cœur, connaissent les répliques, les chansons, les gestes des personnages, et prennent un immense plaisir, entre fans, à les reproduire sur scène devant l'écran. C'est certes plus le phénomène social qui permet cela que le film, mais sans le film, cela s'évaporerait et serait impensable sans. Un récent documentaire nous a montré comment Ghostbusters est aussi devenu un mythe, grâce à la communauté des fans qui se retrouvent autour de leur passion commune.
À côté de ces phénomènes sociaux, on peut évoquer des films qui s'émancipent de la seule narration pour offrir des émotions justifiées par le montage, les plans, la musique, etc. sans qu'elles ne cessent pourtant de participer à cette narration. En ce sens, le film Blade Runner est intéressant, d'autant plus qu'il a été victime d'un spoil tardif : Ridley Scott a affirmé il y a quelques années que Deckart était en fait un réplicant. Beaucoup ont hurlé au scandale, jugeant que le réalisateur avait ruiné ainsi son film, brisé le mystère, alors que le film s'arrêtait sans rien affirmer, laissant le spectateur libre de faire du personnage un humain ou un réplicant. Est-ce le cas ? Le film a-t-il été vidé de tout son contenu, de tout son intérêt, de toute sa poésie ? Non. Les premières images sont toujours aussi fascinantes, efficaces, accompagnées d'une musique qui n'a rien perdu de son aspect aérien, éthéré, à la fois froid, synthétique, et profondément humain, faisant entendre déjà le thème du film. Ces grandes flammes qui s'élèvent dans l'horizon de la ville sont, dès les premières secondes, le symbole de ces réplicants qui brûlent vivement une existence brève mais riche plutôt que de se consumer lentement comme leur créateur, qui les envie autant qu'il peut. La richesse des plans, des scènes, leur symbolisme discret (la chouette qui vole, que Rachel dit être artificielle, est le symbole de l'intelligence : toute intelligence est artificielle), tout en fait un film magique dont on ne peut se lasser. Mais c'est bien parce que le vrai plaisir que l'on prend au film est un plaisir que l'on prend à la matière du film, en tissant des liens entre eux, en recherchant des significations, ce qui n'est possible que par une longue familiarité avec l'oeuvre. C'est la poésie du film, donc, sa capacité à libérer les plans de leur stricte utilité, qui fait la longévité d'un film, sa capacité aussi à créer des nouvelles manières de construire, de montrer, de mettre en scène.
Mais Blade Runner est intéressant aussi parce que c'était un film mystère. Ce mystère révélé, ne reste plus que la poésie des plans. Mais les films de David Lynch sont aussi des films mystères, le twist est montré, il se déroule sous nos yeux, mais leur sens, ce qui est retourné et ce qu'est la situation à laquelle on aboutit suite au twist, tout cela reste à établir ; les indices sont là, sous les yeux, mais semblent toujours échapper à l'analyse. Beaucoup de films sont ainsi, sans que la logique soit aussi furieusement menée. Ainsi, Donnie Darko est donné comme un film difficile à comprendre. Ces films s'offrent à la sagacité des spectateurs, invités à revoir et revoir les films pour déterminer par eux-mêmes ce qu'il y a à voir dans le film.
Phénomènes sociaux, classiques, films poétiques ou mystères, autant de types de films sans réel twist, mais qui accrochent l'attention durablement et promettent un plaisir toujours renouvelé. Ce plaisir est le but d'un cinéma qui n'est pas purement commercial, dont les plans, la musique, etc, ne sont pas purement utilitaires mais servent aussi un but autre, qui est ce à quoi s'identifient ou s'attachent les fans. Mais on voit bien que si le cinéma centré sur l'efficacité évite la surprise pour proposer un spectacle maîtrisé dans tous ses éléments par les spectateurs, si quand ce cinéma propose des surprises finales elles peines à susciter encore l'attention au troisième visionnage, si l'intérêt réel des grands films ne s'apprécie qu'une fois le film pleinement maîtrisé dans sa narration et sa signification, c'est que la peur du spoiler n'est pas le fruit du monde du cinéma, ne découle pas de ses enjeux et de ses techniques. Cette crainte du spoiler est donc bien à chercher dans la psychologie du spectateur, et cette psychologie est bizarrement pathologique parce qu'elle ne semble pas en lien avec ce que le cinéma construit.
On a donc bien tort de craindre le moindre spoiler au cinéma, car cela montre un rapport inauthentique au film, centré sur ce qui n'est finalement qu'accessoire. Mais il serait étonnant que cette crainte ne se rattache à rien d'objectif, qu'elle ne soit que subjective, propre aux individus, et aussi massivement partagée. Elle doit bien, donc, s'attacher à quelque chose d'objectif qui ne serait pas les films eux-mêmes mais sans doute plutôt les conditions matérielles dans lesquelles les films, et les œuvres audiovisuelles en général, sont consommées.
0 notes
Text
Spoiler Alert ! (3) Let’s Twist Again
Nous avons vu que le spoiler ne peut pas être l'objet d'une obsession—car alors il s'agirait de tout autre chose—mais qu'il peut, à la rigueur, être celui d'une phobie. Le spoiler est ainsi la crainte d'une révélation intempestive (à contre-temps), d'une résolution extérieure de la tension entre des craintes et des espoirs portant sur des aspects narratifs et techniques de l'oeuvre. La phobie tient au fait que la résolution interne de cette tension promet de produire un plaisir, quand sa révélation externe aboutit à son contraire. Mais pour que cette phobie soit active, il faut un attachement au film, un intérêt fort, ce qui tend à justifier le rattachement de cette question à la psychologie du spectateur.
Il faut donc se poser deux questions : qu'est-ce qui fait qu'un spectateur va s'attacher à un film ou à une série ; quels sont les mécanismes du plaisir audiovisuel. Les deux sont évidemment liées et on peut les lier d'ailleurs dans une même question : qu'est-ce qui fait que l'on a plaisir à revoir un film ?
Cette question posée nous invite immédiatement à douter de l'importance du spoiler et à minimiser celle de la surprise. Ce serait au fond se méprendre sur ce qu'est une œuvre audiovisuelle que de ne considérer le plaisir qu'elle nous procure que comme la réponse émotionnelle à une surprise. Car si tel était bien le cas, pourquoi diable irions-nous revoir un film que nous connaissons déjà ? Or c'est là que réellement un plaisir et un attachement se manifestent, dans la réitération de l'expérience et du plaisir.
Pourquoi sommes-nous surpris par un film ?
Surprise surprise
La philosophie contemporaine tend à considérer la surprise comme autre chose qu'une émotion. L'émotion est une conduite affective tournée vers le monde et qui, loin d'être une pure passion, est plutôt une action sur le monde. L'émotion n'est pas tant le contrecoup physique et moral d'une action du monde sur moi, qui m'asservirait, mais, comme le dit Sartre, une action d'ordre magique que j'effectue sur le monde, un « système organisé de moyens visant une fin ». Dans la peur, nous dit Sartre, je vise à anéantir ce qui est redoutable en le niant, allant même jusqu'à m'évanouir pour ne plus avoir à le considérer. C'est donc une pratique concertée, orientée vers un but, quoique pas nécessairement consciente.
Au contraire, on peut considérer la surprise d'abord comme un événement que je subis et qui me prive de la possibilité d'agir. Dans la surprise, je suis pris de stupeur et je marque un moment d'arrêt face à ce qui arrive ; loin de pouvoir agir, je suis interdit, manquant des mots, des repères pour répondre à ce qui survient. La surprise perdrait cependant à n'être lue que comme un événement bref ; il est nécessaire de l'inscrire dans le temps, de la lier au passé et d'en penser le prolongement dans l'avenir.
Pourquoi suis-je surpris ? Qu'est-ce qui en moi est pris au dépourvu, troublé ? Ce n'est peut-être rien d'autre que les attentes que j'avais vis-à-vis de l'objet que je considère. Nous sommes surpris parce que voir, ce n'est jamais seulement voir ce qui se présente à nous mais, à partir de cela, c'est attendre d'autres perceptions qui viendraient confirmer, structurer, accompagner ce qui se montre. Ainsi à travers les faces d'un dé, se montrent toujours potentiellement les autres, qui forment un horizon d'attente. La surprise ainsi déjoue toujours une attente, une anticipation. On comprend qu'elle soit un moment de suspens, comme hors du temps, dans lequel un arrêt se marque et dans lequel il soit impossible d'agir, impossible même de dire ce qui se passe car nous n'agissons et n'interprétons ce qui se passe qu'à partir de nos anticipations : interpréter, c'est prévoir toujours, donner une grille de lecture qui permettra de comprendre, de recevoir sans choc ni rupture ce qui ne se présente pas encore mais doit découler, suppose-t-on, de ce qui est présent. Agir, de même, c'est toujours agir sur ce qui est là en anticipant ce qui arrivera. En sport, j'intercepte une passe non en me jetant sur le ballon là où je le vois, mais en coupant sa trajectoire là où je prédis qu'il sera. D'où l'importance des lifts, des effets, qui viennent décevoir ces anticipations, créant de la surprise.
La surprise comme événement met en suspens mon adhésion au monde, annule mes croyances, ouvre à une recherche d'informations supplémentaires permettant de reconstruire a posteriori ce qui a eu lieu, de ressaisir le monde à nouveaux frais. Après la surprise, il nous est ainsi possible de dire « je ne savais pas que ... », « je ne m'attendais pas à ça », « jamais je ne me serai douté », montrant tout à la fois l'ignorance première et sa correction postérieure. La surprise comme affect, qui dure dans le temps, dure peut-être le temps de cette recomposition de la connaissance, est peut-être le moteur de cette recomposition ; c'est l'étonnement, c'est le questionnement, c'est la phase de doute, de scrupules, que l'on traverse quand on envisage à nouveau ce qui nous avait surpris et qui suppose une attention extrême, plus intense en tout cas que l'attention flottante qui caractérisait notre première attitude.
Car il faut bien le reconnaître, si nous sommes surpris, si, sans rien ajouter au monde, il est possible de l'interpréter autrement afin d'éliminer la surprise, c'est que nous ne prêtions pas assez attention à ce que l'on regardait, c'est que l'on a laissé passer des détails, tout un monde implicite auquel il aurait fallu se montrer attentif. La surprise comme affect peut donc être vue comme une attention à l'implicite qui, inaperçu, a constitué le fonds et le lit de la surprise comme événement.
Les techniques du cinéma : surprise, suspens, twist
Comment la surprise fonctionne dans les films ? Si tous les films jouent sur la surprise d'une manière ou d'une autre, certains genres sont plus gourmands, comme le film d'horreur, le film policier ou d'espionnage. On peut reconnaître plusieurs tonalités ou usages. Un usage sporadique : une surprise sans importance, qui détourne de ce qui se passe, apaise une tension ou produit une faible tension, dans une recherche de jump-scare, de rupture de rythme, d'anecdote. Dans le cadre du jump-scare, le but est de faire sursauter, d'effrayer sur le coup par un événement inattendu qui survient sans crier gare. Au contraire, quand il y a construction d'une attente inquiète dans une scène, la surprise laisse place au suspens. Et quand tout le film tend à produire une surprise, à créer un choc par une révélation inattendue, on fait face à un twist. C'est là ce que l'on peut tirer des propos d'Alfred Hitchcock sur la distinction entre surprise et suspens :
There is a distinct difference between "suspense" and "surprise," and yet many pictures continually confuse the two. I'll explain what I mean.
We are now having a very innocent little chat. Let's suppose that there is a bomb underneath this table between us. Nothing happens, and then all of a sudden, "Boom!" There is an explosion. The public is surprised, but prior to this surprise, it has seen an absolutely ordinary scene, of no special consequence. Now, let us take a suspense situation. The bomb is underneath the table and the public knows it, probably because they have seen the anarchist place it there. The public is aware the bomb is going to explode at one o'clock and there is a clock in the decor. The public can see that it is a quarter to one. In these conditions, the same innocuous conversation becomes fascinating because the public is participating in the scene. The audience is longing to warn the characters on the screen: "You shouldn't be talking about such trivial matters. There is a bomb beneath you and it is about to explode!"
In the first case we have given the public fifteen seconds of surprise at the moment of the explosion. In the second we have provided them with fifteen minutes of suspense. The conclusion is that whenever possible the public must be informed. Except when the surprise is a twist, that is, when the unexpected ending is, in itself, the highlight of the story.”
Un film est-il bon, est-il plaisant parce qu'il multiplie les effets de surprise ? Une accumulation de jump-scare fait-elle un film plaisant et leur révélation intempestive risque-t-elle de ruiner le plaisir ? Une seule réponse possible à ces questions : non. Cet effet, jugé simpliste par beaucoup, ne joue que sur le corps et le réflexe de peur. C'est un effet purement physique qui reste aussi fort au second visionnage et qui s'intensifie même de cette connaissance car alors on anticipe l'apparition, on se prépare à ne pas sursauter, mais le corps ne réprimer son réflexe de survie. On ne peut donc pas spoiler un jump-scare. On ne peut pas non plus spoiler l'ambiance angoissante des films, l'ambiance de terreur latente propre aux films d'horreurs asiatiques, dont les effets sont jugés plus élaborés et plus intéressants que les jump-scare à l'américaine. Ces ambiances qui jouent sur les nerfs du spectateur, sur son émotivité et non plus sur ses réflexes, ne peut pas être spoilée parce que le langage peine à les traduire en langage précis et en même temps expressif. On peut bien sûr révéler ce qui va arriver, mais la tension produite par la matière même du film restera intacte.
Reste les twists, qui semblent bien être les seuls éléments qui, révélés, semblent être à même de ruiner le film et le plaisir que l'on en tire. Mais on aurait tort de seulement considérer le twist comme la révélation finale, à le considérer seulement comme « la fin inattendue qui est est en elle-même le climax de l'histoire ».
On peut considérer comme twist tout retournement de situation qui vient perturber l'intrigue ou la compréhension que l'on en a. Le twist final, la révélation inattendue et improbable, vient généralement déjouer les attentes, ruiner la compréhension que l'on avait du récit, mais ce n'est là qu'un exemple de twist, particulier, puisqu'il est un jeu avec le spectateur. Mais l'essentiel des twists se jouent plutôt des personnages, avec la complicité parfois du spectateur. Ainsi l'événement qui fait passer d'une situation initiale équilibrée à une situation de déséquilibre, ouvrant la voie aux péripéties, est un twist, puisqu'il retourne la situation. De même l'événement, attendu, qui viendra établir un équilibre nouveau. Entre les deux, l'événement qui fait passer d'une situation déjà difficile à une situation désespérée (ex : le seul personnage qui accepte d'aider se fait tuer, ou se révèle être un ennemi)
Ce sont sur ces éléments, sur ces twists que les récits de fiction se construisent et si on les révèle par avance, on enlève au film ses principaux effets, ruinant la surprise, empêchant alors certainement le spectateur de s'attacher à l'oeuvre en se laissant surprendre par elle. La curiosité laissant place à une sorte de sentiment de supériorité, à une sorte de mépris de l'oeuvre que l'on regarde dès lors de haut, de toute la hauteur de celui qui sait d'avance et que ce savoir dégoûte.
Les effets du cinéma : spoiler et surprise
Mais si tout cela est parfaitement juste, on ne comprendrait pas pourquoi on a plaisir à regarder plusieurs fois un même film. Si on a plaisir à être surpris par un film, et cette surprise mériterait d'être étudiée pour elle-même, une fois ses effets connus, ne devrions-nous pas nous détourner de l'oeuvre ? Une fois les twists révélés par le mouvement même du film, pourquoi y revenir si le plaisir essentiel réside dans la surprise, ce que tend à faire dire cette phobie du spoiler ?
Prenons l'exemple des films de Night Shyamalan. Ils semblent reposer exclusivement sur le twist final, la révélation qui va perturber l'appréhension globale du film et que l'on n'aura pas vue venir. Passée la stupeur, l'éventuelle jubilation face à ce retournement, passée, donc, la surprise comme événement, on va revenir au film poussé par l'affect de surprise. On aura un plaisir, un plaisir autre, mais ce plaisir durera-t-il ? Combien de fois peut-on voir le 6e sens ? Deux, trois fois, mais très vite, le sens du film sera épuisé, pleinement saisi, et le goût n'y sera plus. C'est le problème des films à twist final ; si c'est là leur seul ressort, le film ne survit pas à la révélation qu'il apporte. Quel est ce plaisir cependant que l'on ressent la seconde fois ? Il va sans dire qu'il ne peut pas être le même que la première fois. Si la première fois nous sommes surpris par l'histoire, cette dernière ne peut plus nous étonner dès lors qu'on la connaît. La seconde fois, la surprise naît non pas de l'ignorance et de l'inattention mais au contraire de la connaissance et de l'attention scrupuleuse : nous sommes alors surpris par les moyens mis en œuvre par le réalisateur ou le scénariste, moyens techniques et narratifs, pour déjouer nos attentes, provoquer des anticipations contrefactuelles tout en donnant suffisamment d'indices pour que le second visionnage construise un tout autre film. En l'absence de cette seconde surprise, attentive, savante, qui procure le plaisir cinéphile, le spectateur se sent floué et abusé. En l'absence aussi d'une matière suffisamment riche et indépendante autour des retournements narratifs, le film s'épuise vite. Ce qui procure le plus de plaisir n'est donc jamais l'ignorance, mais la connaissance et la connaissance toujours plus approfondie de la matière du film et de comment tous les éléments ensemble concourent à produire une histoire dense et surprenante.
On peut ainsi distinguer, à partir de ces réflexions, deux types d'attachements à l'oeuvre. Le premier, qui en reste à l'événement de la surprise, sans guère pousser à revoir l'oeuvre, est attachement esthétique (lié à l'émotion) à l'effet produit par l'oeuvre : la surprise, la jubilation qui en découle, la stupeur, le frisson, etc. « On en garde un bon souvenir », comme on dit, mais on est plus attaché à l'effet qu'au film et c'est pour cette raison que souvent on se refuse à le revoir, pour ne pas ternir le souvenir, pressentant déjà que l'effet ne survivrait pas à un second regard. Le deuxième attachement est attachement à l'oeuvre elle-même, attachement construit à partir de la surprise comme affect qui pousse à connaître, à revoir, à analyser, à épuiser la matière du film pour faire, de ce film menaçant le regard, déstabilisant, un monde entièrement maîtrisé à nouveau ; ici la surprise devient émotion c'est-à-dire, comme dit au début, démarche concertée, action sur le film à fin d'en maîtriser les aspects, de les produire soi-même par la découverte et l'analyse, faisant du film non plus seulement un spectacle à recevoir passivement mais une œuvre ouverte, comme le dit Umberto Eco, à co-construire avec l'équipe de production dans le mouvement d'une réception active.
#cinema#philosophie#pop philosophie#jump scare#horreur#m. night shyamalan#hitchcock#suspens#surprise#angoisse#ambiance#porno#mega vixen
0 notes
Text
To be or not to be

Il y a de la difficulté sur ce « to be or not to be ». Il serait facile de dire que c'est parce qu'on ne lit plus. Mais quand vient même, ça resterait coton, Shakespeare. Et puis, il y a Lubitch. Mais le noir et blanc, plus personne ne le voit. C'est bien dommage, mais là encore, quel lien avec Hamlet ? Enfin, on dira que c'est par manque de philosophie. On ne philosophe plus. On croit que le moyen-âge n'a connu aucun philosophe. C'est un tort sans doute mais là encore, qu'est-ce que cela a à voir avec Hamlet ?
Tout.
Car dès lors que l'on pousse plus loin que les premiers mots, on est perdu. La manière dont la postérité a gardé cette tirade est trompeuse. Ce n'est pas du tout une question sur l'identité, sur qui on est. Ni sur l'essence, ni sur l'existence. Il suffit de pousser plus loin pour voir que ce n'est pas ça qui est en jeu. Mais qu'est-ce qui est en jeu alors ? Là-dessus, un détour par la philosophie.
Hamlet est un étudiant. Un aspirant philosophe qui s'en revient de Wittenberg où enseigne Melanchton, dont l'enseignement rhétorique consiste à faire passer des questions finies, portant sur une situation particulière ou un individu, aux questions infinies, portant sur le général. Selon Goyet, Hamlet double l'infinité de la question. D'abord, en passant d'une question le concernant directement, lui, à une question très générale. Puis de cette question générale il en fait une question infinie au sens propre du mot : sans terme. Ainsi, il s'offre un espace de temps où, entre questions philosophiques et folie feinte, il s'offre le temps de réfléchir à ce qu'il doit et va faire.
Il soulève ce que les scolastiques appellent une question disputée, ou libre. Une question quodlibétique, donc, qu'il soulève seul. Chez Mélanchton, cela s'appelait la thèse, posée sous forme d'alternative comme la disputatio, et formait l'exercice le plus élevé dans son école. La disputatio suit des règles strictes chez les scolastiques. D'abord, on construit la question sous la forme d'une alternative. Ensuite, on rassemble les contre-arguments, puis les arguments en faveur de la thèse. Après avoir résolu l'alternative, on juge à nouveau frais les divers arguments.
Mais d’abord, la tirade :
To be, or not to be--that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortune Or to take arms against a sea of troubles And by opposing end them. To die, to sleep--No more--and by a sleep to say we end The heartache, and the thousand natural shocks That flesh is heir to. 'Tis a consummation Devoutly to be wished. To die, to sleep--To sleep- perchance to dream: ay, there's the rub, For in that sleep of death what dreams may come When we have shuffled off this mortal coil, Must give us pause. There's the respect That makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely The pangs of despised love, the law's delay, The insolence of office, and the spurns That patient merit of th' unworthy takes, When he himself might his quietus make With a bare bodkin? Who would fardels bear, To grunt and sweat under a weary life, But that the dread of something after death, The undiscovered country, from whose bourn No traveller returns, puzzles the will, And makes us rather bear those ills we have Than fly to others that we know not of? Thus conscience does make cowards of us all, And thus the native hue of resolution Is sicklied o'er with the pale cast of thought, And enterprise of great pitch and moment With this regard their currents turn awry And lose the name of action.
Dans la traduction de Victor Hugo :
Être, ou ne pas être, c’est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d’âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s’armer contre une mer de douleurs et à l’arrêter par une révolte? Mourir.., dormir, rien de plus... et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair: c’est là un dénouement qu’on doit souhaiter avec ferveur. Mourir.., dormir, dormir! peut-être rêver! Oui, là est l’embarras. Car quels rêves peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l’étreinte de cette vie ? Voilà qui doit nous arrêter. C’est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d’une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l’injure de l’oppresseur, l’humiliation de la pauvreté, les angoisses de l’amour méprisé, les lenteurs de la loi, l’insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d’hommes indignes, s’il pouvait en être quitte avec un simple poinçon? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort, de cette région inexplorée, d’où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté, et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas? Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches; ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée; ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours, à cette idée, et perdent le nom d’action...
Prenons donc la tirade dans l'ordre. D'abord, le jeune Hamlet construit sa question, pose l'alternative. « être ou ne pas être » n'est que la forme de la question. Oui ou non. Tout ou rien.
« Y a-t-il plus de noblesse d’âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s’armer contre une mer de douleurs et à l’arrêter par une révolte? Mourir.., dormir, rien de plus... »
« Whether 'tis nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortune Or to take arms against a sea of troubles And by opposing end them. »
Donc, se révolter ou s'écraser. Avec comme corollaire le risque de mourir, en cas de révolte : « Mourir.., dormir, rien de plus... » « To die, to sleep--No more »
Ensuite, il s'assomme littéralement de contre-arguments, tous très forts.
« Mourir.., dormir, dormir! peut-être rêver! Oui, là est l’embarras. Car quels rêves peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l’étreinte de cette vie ? Voilà qui doit nous arrêter. »
Il faut, pour savoir s'il faut se révolter, considérer la mort et ses conséquences pour l'âme. C'est la considération de la mort et de ce qui nous attend dans la mort qui fait que nous supportons tous nos malheurs. Il vaut mieux ainsi supporter l'injustice que de la commettre, comme le disait le Socrate de Platon, il vaut mieux vivre malheureux que de mourir criminel.
« C’est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d’une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l’injure de l’oppresseur, l’humiliation de la pauvreté, les angoisses de l’amour méprisé, les lenteurs de la loi, l’insolence du pouvoir, et les rebuffades que le mérite résigné reçoit d’hommes indignes, s’il pouvait en être quitte avec un simple poinçon? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort de cette région inexplorée, d’où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté, et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas? »
Il aurait certainement pris le temps de lister les arguments positifs s'il n'était pas interrompu dans ses réflexions. Cela dans un but évidemment théâtral. S'il interrompt sa réflexion sur une note résignée, on croit dès lors qu'il abandonne l'idée de lutter et de se révolter. Qu'il abandonne la partie : « la conscience fait de nous tous des lâches; ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée; ainsi les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours, à cette idée, et perdent le nom d’action ». On rajoute de l'incertitude à la pièce : que va-t-il décider maintenant qu'il a décidé de renoncer ? Se lancer dans le théâtre peut-être, comme la scène suivante semble l'indiquer ? Cette incertitude ménage aussi une surprise quand il affronte finalement l'assassin de son père.
Il y a bien cependant un moyen de considérer cette interrogation comme une interrogation sur l'identité, mais seulement à considérer que l'identité n'est pas atteinte par la connaissance (qui suis-je?, que suis-je?) mais est en fait une catégorie de l'action. Ce que je suis dépendra des actes que je ferais, ce que je suis n'est que le produit de mes actes. Je suis courageux par l'acte courageux, révolté par la décision de me révolter. Ce que l'on est, ou n'est pas, dépend donc de nos résolutions, de ce que l'on estime être la meilleure décision possible, le meilleur choix. L'identité est, en dernière analyse, une catégorie morale.
Et Lubitch là-dedans ? Son film, To be or not to be présente une troupe de théâtre interprétant Hamlet dans la Vienne, à la veille de l'invasion allemande. Le titre insiste sur la célèbre tirade parce que la femme de l'acteur qui joue Hamlet profite de cette scène pour voir dans sa loge les spectateurs qui la courtisent. Ainsi, à chaque fois que la tirade est prononcée, un spectateur se lève, ce qui a le don d'irriter l'acteur. On voit aussi les contradictions des acteurs, leur irrésolution primitive, essentielle en un sens, puisque ce sont des être qui ont plusieurs visages (l'actrice volage ne cesse d'évoquer son maquillage). Les acteurs de second plan sont las de jouer les porteurs de Hallebarde, mais ne font rien pour jouer d'autres rôles. L'actrice voit ses courtisans dans le dos de son mari mais refuse de se dire volage, bien qu'elle s'envoie en l'air, au sens propre, avec un pilote d'avion. Mais après l'invasion allemande et la déclaration de guerre, portés par l'urgence de la situation, ils se retrouvent tous contraints de participer à l'Histoire, de devenir, non plus des personnages, mais des héros. Là intervient une seconde interprétation de la tirade, moins triviale. Qu'est-il plus noble de faire ? Doit-on lutter contre l'injustice ? Doit-on, comme se le demande Hamlet, se révolter ? C'est là une question pratique résolue pratiquement et comme dans la pièce, par le biais du jeu théâtral. C'est en incarnant des rôles qu'ils deviennent des héros, qu'ils sortent de leur indécision première pour tendre entièrement vers l'action, dépasser leur inconfort pour asseoir et imposer leur désir : les seconds couteaux obtiennent des rôles cruciaux, la femme volage ne fait rien d'autre que courir vers son mari, quel que soit les divers masques qu'il porte.
0 notes
Text
Les poings sur les i
“Et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer
Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit
Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie”
Début de soirée, Nuit de folie
Vice vient de poster un vieil article crétin sur Fight Club. L'auteure, Megan Koester, qui a surtout écrit sur son alcoolisme, semble ne l'avoir écrit que pour provoquer les réactions. C'est triste un pure player. Condamné, pour exister, de réclamer et de ressortir régulièrement des articles taillés non pour informer et éclairer, mais seulement pour pousser l'internaute à cliquer puis à rager dans les commentaires. C'est triste qu'un journal web doivent s'abaisser à cela pour exister, mais c'est Vice. Le cul, la drogue, tous les sujets dits tabous, ceux qui font cliquer, la mise en avant de l'auteur, moins façon gonzo que façon blog. C'est une manière d'écrire, journalisme d'opinion, dont la forme et le fond dépend intégralement non de l'auteur, mais des exigences techniques et sociales qu'imposent le médium. Une école de la soumission, donc. Non de la liberté.
Cet article de Megan Koester est autant l'article d'un échec personnel que celui d'un format. D'un site. La titraille affirme que le film est sexiste, pseudo-intellectuel, porteur d'une violence pornographique manifeste. Donc le film est un mauvais film, immoral et crétin, non ? Sauf que vers la fin, il nous est dit :
« Palahniuk wrote Fight Club as satire, as an examination of the horrors that lie within the juvenile male id. At the end of the book and film, the narrator is shown standing before the destruction said id created, regretting what it has done. Which is all well and good, but that isn’t the message the average audience, the average red-pill-popping Redditor, takes away. »
« Palahniuk a écrit fight club comme une satire, une exploration des horreurs tapies au fond de l'identité des jeunes mâles. À la fin du livre comme du film, on voit le narrateur regretter ses actes, face à la destruction qu'il a lui-même engendrée. Ce qui est fort bien, mais ce n'est pas le message que retient le spectateur moyen, l'adepte moyen des forum red-pill de reddit. » (traduction rapide)
Outre le fait qu'à la fin du livre, rien n'explose, que le narrateur est jeté à l'asile par des membres du projet chaos prêts à poursuivre l'oeuvre—ce qui montre que l'auteure ne sait clairement pas de quoi elle parle—ce qu'elle dit là semble dire que le film est intelligent, mais que son public est crétin. Il faudrait choisir. Il suffit pas de cracher sur qui on était à 16 ans pour se montrer intelligent ; il faut encore éviter de trop se contredire.
Si on fait abstraction du ton condescendant, on retire quelques maigres jugements : le film est taillé pour une population de gamers, d'où le ton de l'ouverture, qui évoquerait l'imagerie d'un jeu vidéo. Les personnages sont castrés par les femmes ou la féminité. Ils sont des pleurnichards qui se frappent les uns les autres pour passer leur frustration. Je vais pas développer outre mesure dessus, mais, répondons à ces jugements un peu trop hâtifs.
Générique
youtube
Je ne vois pas ce que cela a à voir avec les jeux-vidéos, mais si un lien peut être fait, il faut reconnaître qu'en 1999, ils n'étaient pas légion les films qui puisaient efficacement à l'imagerie des jeux-vidéos. Matrix d'ailleurs est certainement un meilleur exemple, tant Fight Club puise à toutes les imageries. C'est un miroir déformant de toute la culture, dans son unité, il en dévoile le fond, la vérité, sous la forme du satire oui, d'une comédie par laquelle on peut reprendre une position de sujet, surmonter ce qui ordinairement nous dépasse, nous écrase, à défaut, nous menace. Mais ce générique est plus qu'une simple introduction. Prenons une distinction assez simple, bien que légèrement détournée. Disons que ce générique est à la fois diégétique (il dit quelque chose d'important sur le film, participe à sa narration, est pris dedans) et extra-diégétique (il est fonction d'un traitement extérieur à l'action du film). Diégétiquement, il nous montre que tout sort de la tête du narrateur. Les éclairs lumineux qui illuminent anarchiquement ses synapses ont tout du déréglé, de la secousse, du troublé, et de ce trouble, tout le film, l'action, les idées sortent. Dès la première image, on sait sans le savoir, on le voit sans le comprendre, tout n'est qu'hallucination du narrateur, tout sort de son esprit, de son cerveau fatigué. Extra-diégétiquement, cela est la mise en œuvre d'une camera qui ne représente aucun point de vue assignable, qui n'est pas un point de vue possible, celui d'un personnage ou d'un spectateur présent, c'est une caméra qui flotte, qui se place dans la continuité de ce que le premier plan de Boulevard du crépuscule a instauré : une caméra désincarnée qui peut prendre arbitrairement le point de vue qu'elle veut, même s'il est impossible. C'est par là que le cinéma s'est rapproché du jeu vidéo en grande partie, par des plans de caméra qui montrent la scène en tournoyant, qui zoom sur les détails importants, qui suit les personnages en passant dans l'anse des tasses, sous les voitures, etc. Mais là encore, cela dit quelque-chose du narrateur : il est dissocié de lui-même, le regard qu'il porte sur le monde, qui devrait déterminer les plans de caméra, flotte, se détache de ce qui compte, passe d'une échelle à l'autre, il ne sait pas fixer son attention et se retrouve à ne voir que ce que son esprit produit.
Femme fatale et femmelettes
Il me faudrait me replonger dans le film, mais je peux déjà dire une chose. Oui, il y a tout un discours sur ce qu'est un « vrai mec ». Un discours sur la virilité. L'homme est celui qui décide des réponses qu'il apportera à ses problèmes, et qui met tout en œuvre pour les résoudre comme il l'entend. On admire pour cela les artistes et ces autres créateurs que sont les patrons d'entreprise. Les ingénieurs. Mais il y a toute une population de subalternes qui n'ont aucune latitude, aucune marge de décision, qui sont écrasés par un discours surplombant, qui leur impose leur activité, leurs méthodes, qui les privent donc de leur condition de sujet. Les grands malades aussi sont dans ce cas, réduits à leur maladie, incapables de se soigner eux-mêmes, condamnés à s'en remettre à la parole d'un médecin, condamnés à se résigner à leur état, plus guère acceptés que par ceux qui partagent leur situation. La possibilité de se retrouver entre semblables, d'aider, même du fond de sa propre détresse, voilà qui sauve, qui permet de dormir avec le sentiment du devoir accompli.
Le sport est un moyen que le société nous enjoint d'embrasser pour passer nos frustrations. On court, on se défoule, on se construit une santé et un corps parfait, mais cela est une manière d'accepter le sort qui lui est fait. Là où le film fait un pas de côté par rapport à cet hygiénisme, c'est que le but n'est pas de se faire un corps parfait : oeil au beurre noir, dents et nez cassés, blessures diverses, toutes ces entorses aux règles de la présentation de soi, montrent que l'on n'est pas réellement attaché à ces règles, qu'elles ne sont rien que des conventions que l'on peut arranger, changer, briser. Cela, seuls les marginaux le savent, mais d'un savoir malheureux, d'un savoir qui les exclu et les écrase. Ici, ce savoir transforme le corps, l'esprit, endurcit, prépare à l'action. Ce ne sont donc plus des pleurnichards : ce sont des individus qui se croient transformés, le sont réellement, physiquement, même s'ils n'ont pas vu qu'ils sont à eux-mêmes leur propre dépression et qu'ils ont déjà perdu leur guerre spirituelle : cette transformation, ils ne la mettent pas au service de leurs propres buts, mais au service d'une névrose qui ne réclame qu'une chose : l'annihilation du monde moderne, des règles sociales, pour permettre à chaque individu d'être lui-même, mais comment le deviendraient-ils eux qui n'ont jamais appris à l'être ?
Reste le rapport aux femmes. Marla est une menace. Mais il faut bien comprendre qu'elle n'est une menace que parce qu'elle tient au narrateur, que lui aussi est étrangement attaché à elle, qu'il se repose sur elle pour sortir de son cauchemar et que ce n'est qu'à cause de cela qu'elle est rejetée et menacée. Rien à voir avec un rejet misogyne. Elle est une porte de sortie hors de la névrose, une promesse de compromis entre les règles du monde et la recherche d'une autonomie, la possibilité d'un monde intermédiaire entre la destruction et la résignation. Or, l'amour comme révolution n'est pas une option dans Fight Club.
0 notes
Text
La cantatrice chauve
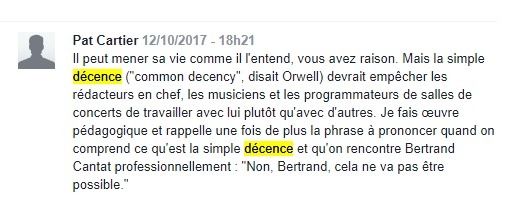
Je crois qu'on peut dire que Cantat est devenu un marronnier. À chaque fois qu'il sort un album, les mêmes débats ressortent, qui ne sont pas réellement des débats, puisque à l'heure d'internet, le débat est déballage. Avis contre avis, opinion contre opinion. Quelques interventions sortent du lot, forcément, mais dans l'ensemble, un sentiment lourd accable celui qui essaye de s'intéresser à ce qui se dit et pense. Il y a un risque toujours aussi à parler sur l'affaire car cela, aux yeux de beaucoup, revient à choisir un camp. Et donc des ennemis. Et dans ce combat certains arguments sont plus bêtes que les autres. Comme le fait de voir un signe dans la présence des noms de Cantat et Orelsan sur la couverture du numéro des Inrocks. Comme si c'était un pied de nez, alors que la thèse d'une double actualité sans lien est plus crédible.
Ce qui est regrettable, c'est qu'encore une fois, on rate pour l'essentiel le débat. Oui, il y a un énorme problème de société qui doit être pris à bras le corps et résolu une bonne fois pour toute ; oui, les femmes doivent pouvoir ne plus être ces victimes éternelles dans l'espace public, doivent pouvoir ne plus être la proie toute désignée du moindre passant, du supérieur hiérarchique, du conjoint ni du copain. Mais ce n'est pas en ravalant le meurtre de Marie Trintignant à une sombre affaire « Cantat » accompagnée d'insultes et d'exhortations à la mort, réelle, sociale ou médiatique, que ce débat pourra être mené. C'est une autre manière de refuser la lourde tâche qui nous incombe d'insulter l'homme et de s'ériger en défenseur de la décence, insultant par là-même l'homme et la décence. Car la décence, c'est d'abord ne pas verser dans des dérives qui si elles n'entraînent pas mort de femme, n'en sont pas moins indignes.
Oui, nous sommes à une époque où les violences faites aux femmes passent de moins en moins. Oui, c'est une merveilleuse chose, même si les paroles plus libres révèlent l'ampleur de la barbarie quotidienne de notre société, de notre culture. Oui, à une époque où éclatent les affaires Baupin, Weinstein, Cosby, il est nécessaire de trouver les outils pour aider les victimes à se reconstruire, pour protéger celles qui pourraient le devenir, pour faire changer nos représentations et abandonner les attitudes, comportements et actes qui se décident sur ces dernières.
Mais la question se pose : un lynchage médiatique permettra-t-il cela ? Rabattre cela sur Cantat fera-t-il avancer la « cause » ? A plus forte raison quand on est une élue (Marlène Schiappa) ; cela donne l'impression que la justice ne rend pas justice et que c'est la société dans son intégralité qui dois faire obtenir réparation à la victime, par une levée de boucliers qui revient purement et simplement à empêcher un homme de vivre parce qu'il a tué. Mais dire cela n'est pas défendre l'homme, c'est défendre la société. Si la justice s'érige entre la société et les criminels, c'est pour éviter ce dernier de se faire lyncher ; pour que quand il ressorte, il puisse, non pas être blanchi, mais avoir l'occasion de reprendre une place. Or cette place, si c'est à lui de la retrouver, avec toutes les maladresses et les difficultés que l'on peut imaginer, c'est aussi à la société de la lui donner, aussi délicat que cela soit. Et à une époque où la justice repense ses moyens pour repentir nos criminels, il est indécent de nier les efforts faits, les pistes ouvertes, pour retomber dans une sorte de moyen-âge.
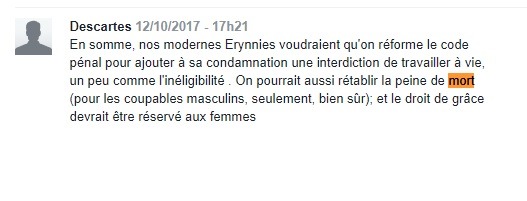
Car ceux qui voudraient le voir disparaître n'ont sans doute jamais entendu parler de justice restauratrice. Ce dispositif permet de faire se rencontrer des victimes et des coupables qui ensemble cherchent les réponses qui leurs manquent, se révèlent, se découvrent, s'amendent, surmontent l'événement qui les lient. Se reconstruire comme personne au delà de l'acte commis, pour ne plus être seulement un criminel, au delà de l'acte subit, pour ne pas être seulement une victime. Ce dispositif permet de faire que le criminel répare symboliquement une partie du mal qu'il a fait.
Cela peut se transposer dans l'espace des débats sur ce genre de crimes. Refuser de faire ce même effort, condamner le condamné à n'être plus que l'éternel criminel, ce paria définitif, cela ne peut qu'enfermer le criminel dans son acte. Cela, pire, enferme la société dans un rôle d'éternelle victime, avide de justice face à un criminel contraint dès lors de toujours se justifier. Dans un tel emballement, force est de redire l'essentiel. Il n'y a de victimes que Marie Trintignant et ses proches. Le rôle d'une société démocratique n'est pas d'en appeler à la vendetta, mais devrait être de pouvoir restaurer, non pas de nier le crime, non pas de nier la capacité de « payer sa dette » : comme ces jeunes américains qui font le tour des campus, après avoir tué dans des accidents de voiture, pour faire de la prévention routière, comme Alain Caillol, qui avait séquestré le Baron Empain, qui faisait la tournée des plateaux à l'occasion de son livre pour dire à tous ceux qui seraient tentés de l'imiter qu'il n'est pas un modèle et qu'il y a mieux à faire de sa vie.
youtube
Entendant cela, peut-on reprocher à Bertrand Cantat de manifester et d’exprimer ses sentiments, ses émotions, de faire part de projets ? Non. Bien sûr, on peut regretter que l’on ne lise que ses propos, non ceux des proches de la victime, mais est-ce que les Inrocks est le lieu pour une table ronde entre Cantat et Trintignant ? Non. Mais par presse interposée, à condition d’un débat sainement mené, à condition d’écoute des deux parties, à condition d’une volonté unanime de tirer non un trait, mais des leçons et des guides pour l’avenir, en tout pragmatisme et loin de toute morale grandiloquente. En un mot, à condition d’avoir un peu de décence.
Tout ce qui manque à notre société pleine de morgue.
0 notes
Text
Convergences : cinéma et jeux-vidéos
C'est maintenant une évidence, mais le jeu-vidéo est un art à part entière. Sauf que comme pour le cinéma au départ, le jeu-vidéo emprunte énormément aux autres arts, qu'il synthétise de manière neuve et interactive. Musique, peinture, angles de vue inspirés du cinéma, narration littéraire, puis dramaturgique, etc. même si au cœur du jeu vidéo, il y a surtout l'interface et les mécaniques de jeu.
Ce qui permet à des jeux de se réduire uniquement à cela, des mécaniques simples et une interface adaptée, les « idle games » et autres « clickers », jeux réduits à leur plus simple expression comme la peinture avec l'abstraction et le cinéma avec les expérimentations lettristes puis situationnistes, ce que ces derniers appelaient la phase « ciselante », ciselement de la représentation réaliste adaptée aux usages d'internet. Mais je parlerai de tout ça une autre fois.
Ce qui m'intéresse ici, c'est la phase « amplique » du jeu vidéo, celle qui court vers une représentation toujours plus ample et perfectionnée d'une réalité qui implique et absorbe le joueur. Elle n'a été possible que par des emprunts toujours plus massifs aux arts précédents, au cinéma en particulier, auxquels les joueurs étaient déjà familiers et qui ont pour effet de renforcer l'implication du joueur en exploitant un langage qu'il maîtrise déjà. À noter qu'aujourd'hui, et de plus en plus, c'est le cinéma qui emprunte son langage au jeu vidéo afin de concevoir des mises en scènes, des plans qui parlent à une génération de spectateurs qui ont grandi avec les jeux.
On prendra deux exemples pour cela : un qui concerne la musique et montre l'influence des musiques de films dans un jeu. L'autre qui est plus influencé dans son histoire ou sa mise en scène.
Final Fantasy a été pour beaucoup la première grande expérience immersive dans un jeu vidéo. Tout y participait : l'histoire longue qui se complexifie avec le temps, les relations denses entre les personnages, les graphismes, l'univers, vaste et absolument ouvert, fait de détails humoristiques et de quêtes annexes. Et bien entendu la musique. Cela faisait du jeu plus qu'un jeu mais au moins un film interactif, dans lequel se plonger, au plus une partie même de l'existence du joueur. Il fit de Nobuo Uematsu une idole aux yeux d'un grand nombre de joueurs. On pourrait évoquer les influences du compositeur mais cela n'aurait qu'un intérêt relatif. Il importe plus de comprendre les exigences d'un thème musical de jeu-vidéo et comment ces exigences ont été remplies grâce à des emprunts aux musiques de film.
Un thème est une séquence musicale destinée à être reprise, répétée, qui accompagne un personnage, une situation ou une émotion. Cela est important dans un jeu vidéo où les personnages ne parlent pas, sont vus pour l'essentiel de loin. Le thème doit alors donner à sentir le personnage, parler pour lui ; cela vaut aussi pour les lieux. L'émotion associée à un lieu doit immédiatement produire une émotion ou une ambiance identifiable sans difficulté : mystère, apaisement, joie, excitation, crainte. On peut prendre par exemple le thème de la ville de Baland, Breezy. Balamb est une petite ville portuaire, d'où vient Zell, jeune adolescent turbulent qui n'a qu'un souhait, quitter la ville et partir à l'aventure, qui s'y sent à l'étroit et y a toujours des ennuis. Elle est donc à ses yeux une « petite ville ennuyeuse », une « wicked little town ». Le thème Breezy est très proche de la mélodie qui ouvre la chanson wicked little town, dans le film Hedwig and the angry inch.
Breezy:
youtube
Wicked little town:
youtube
Une des chansons les plus entraînantes et les plus enthousiasmantes est celle qui accompagne le vol du Ragnarok, vaisseau spatial rapide et maniable qui ressemble à un dragon. Le thème, « ride on », qui nous invite à voler à toute vitesse au dessus de la map, ressemble grandement au « Bastian's happy flight » de l'Histoire sans fin, musique accompagnant, évidemment, la scène où Bastien chevauche dans les airs Falcor, son dragon. D'autres musiques devraient pouvoir être rapprochées ainsi de musiques de films, soit directement soit dans l'ambiance qu'elles installent.
Ride On:
youtube
Bastian’s happy flight:
youtube
L'autre manière d'emprunter au cinéma est de s'appuyer sur les personnages, la narration ou les situations. Le créateur de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, n'a jamais caché son ambition première de faire du cinéma, ambition qui a progressivement trouvé à se manifester dans les jeux vidéos qu'il concevait. Les personnages du premier metal gear étaient calqués sur le visage d'acteurs célèbres, et les épisodes sont truffés de références à divers films, le plus important étant New-York 1997. Mais le fait de rapprocher un personnage d’un acteur, d’un rôle, permet, en rappelant le film, d’enrichir le personnage de toute l’épaisseur du film, de tout l’imaginaire qui s’y trouve rattaché. Cela était nécessaire à l’époque où les machines n’étaient pas assez performantes pour permettre d’atteindre le même objectif directement avec le jeu (on pourrait aussi évoquer la jaquette du jeu, reprenant le personnage du film Terminator, Kyle Reese.


Mais tout cela est mieux connu et mérite juste ici, pour le moment, d'être évoqué.
0 notes
Text
Sottisier
Méditer, c’est pompeux comme mot pour dire qu’on rêvasse la tête dans les nuages, qu’on pense que du vent. Moi j’appelle ça péter personnellement, mais certains disent méditer. Soit. Lisons donc un méditant. Deux en fait, qui nous montreront que deux penseurs valent la moitié d’un. François Comba d’abord, une recherche rapide sur Google ne donne que des résultats liés à Harry Potter, une vague info semble faire de lui un Historien, on pourra en voir la qualité. L’autre, Alexis Loisel, reste un parfait inconnu malgré une rapide recherche. Et c’est peut-être pas plus mal.
Ces deux pieds-nickelés ont écrit sur un obscure site, profondeur de champ, une “méditation sur un tableau de Rembrandt, le philosophe en méditation. Voilà ce qu’ils en disent :
On se souvient de Sartre : “J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres” (Les Mots, Pléiade, p. 20). Depuis Descartes, philosopher suppose de lire et d’écrire. Issue des mathématiques, la philosophie en a conservé la rigueur, qui exige la rature. Apparemment, à l’époque de Rembrandt, ces évidences n’étaient pas encore acquises. La philosophie ne s’obtenait pas par le travail ; elle naissait de la rêverie. On avait surtout besoin d’une certaine qualité d’ombre et de silence. Ces deux composantes se retrouvent en effet dans ses œuvres, à l’image de ses portraits, où d’imposants corps pâles trônent au centre des toiles à fond sombre, en s’y détachant nettement par clair-obscur.
Dire que la philosophie est affaire de livres et de rigueur, c’est sans doute pas faux, la lier aux mathématiques non plus. Mais alors il faut le dire : c’est dès l’antiquité, dès Pythagore et Thalès, si on y tient depuis Platon, c’est dire que ça date ! Alors dire après ça que du temps d’un tel, ces “évidences” (il y aurait tant à dire là-dessus !) n’étaient pas encore acquises, c’est stupide. Premier Croquignol.
Ensuite, opposer Descartes, qui lit et écrit, au personnage du tableau, qui médite à la fenêtre, dans une “certaine qualité d’ombre et de silence”, c’est débile, quand on sait que Descartes s’est enfermé dans un poêle, qui sans doute devait être assez proche de ce que le tableau montre. Second Filochard.
Pour couronner le tout, final Ribouldingue, le texte est d’une stupidité profonde puisque ... Descartes et Rembrandt ont vécu à la même période ! Pire, Descartes se trouve aux Pays-Bas dès 1632, année à laquelle le tableau est peint et publiera 5 ans plus tard le discours de la méthode. En 1637. Alors parler d’époque ! pour une différence de 5 ans ! il y a de quoi rire. D’autant plus qu’un des deux auteurs est présenté comme un “historien” ...
http://profondeurdechamps.com/2014/02/09/le-philosophe-de-rembrandt-une-meditation/
0 notes
Text
The Fall of the House of U-Shame (Shaq Fou 2)
Donc, prendre Shaquille O'neil par la main, et le guider dans sa quête, ou plutôt, faire de ses certitudes stupides une quête. Être un Socrate pour cet Aristoddler. Être un Virgile pour ce Dante perdu dans ses linges. Ne pas avoir peur de partir loin.
Et c'est sûrement bien d'être un Virgile en l’occurrence, puisqu'il nous faudra être vigilent, c'est-à-dire, faire attention. Pas comme une mère qui veille son enfant, pleine d'attendrissement, mais Virgile, Vigilent viril, comme un vigilente sauce comics, les yeux grands ouverts et le taquet prêt à partir.
Comme lui quoi :

Vigilent déjà au fait que Shaquille, malgré tout ce qui le dessert, n'est que la moitié d'un con. C'est dire qu'il est presque intelligent et on va le suivre, mine de rien. Pour ça : on va le réécouter, même s'il nous en coûte.
« It’s true. The earth is flat. The earth is flat. Yes it is. Listen, there are three ways to manipulate the mind — what you read, what you see, and what you hear. In school, first thing they teach us is, ‘Oh, Columbus discovered America,’ but when he got there, there were some fair-skinned people with the long hair smoking on the peace pipes. So what does that tell you? Columbus didn’t discover America. So, listen, I drive from coast to coast, and this s**t is flat to me. I’m just saying. I drive from Florida to California all the time and it’s flat to me. I do not go up and down at a 360-degree angle, and all that stuff about gravity, have you looked outside Atlanta lately and seen all those buildings? You mean to tell us China is under us? China is under us? It’s not. The world is flat. »
Que tirer de tout ce galimatias ? Et bien c'est là qu'on voit que son conflit des facultés, ses deux débuts de raisonnements qui se parasitent, son génie contrabalancé par son petit crétin-intérieur, prompte au croque-en-jambe. Il faudra être un Virgile pour son génie, un Socrate pour son demeuré.
Embarquer l'un, laisser l'autre à demeure.
Gods in Alterica
Mais faut le socrater d'abord ! ruiner ses certitudes et l'envoyer paître dans le désert du réel. Pas qu'il parte avec ses délires, marchant à côté de ses pompes, mais qu'il file droit, droit à la conclusion. Donc, d'abord, montrer brièvement que ses arguments à la con, c'est de la fallace. Qu'on construit rien avec. Ni des raisonnements ni des palaces. Rien que de la chiasse.
D'abord, il y aurait eu avant Christophe Colomb des blancs aux Amériques. C'est ce qu'il nous dit, fait, fait-alternatif, boniment, laissons ça de côté pour le moment. Regardons ce qu'il en conclut : Colomb n'a pas découvert les Amériques. Il faut percevoir le sous-entendu derrière, ce qu'il dit, c'est que d'autres ont découvert les Amériques, d'autres blancs. Sous entendu : pas de blancs autochtones aux USA, non madame. D'où venaient-ils alors ? Certainement : d'Europe. Il pense sans doute aux Vikings, on sait que les Hoax sur des restes Vikings découverts sur le sol américain sont légions, et font aussi partie des mythes ; le Greenland découvert par Erik le Rouge n'aurait pas seulement été le Groenland, dont l'appellation serait dès lors ironique, mais aussi la côte nord du continent américain. Ce que l'on retrouve dans le film de Refn, Le guerrier silencieux, que l'on retrouve dans la série Gods in América.

Mais ça gamin c'est raciste, c'est essentialiser le « blanc » comme le blanc essentialise le « noir ». C'est dire tout individu blanc ne peut être qu'un occidental européen, ou un descendant à quelque degré d'un occidental-européen. C'est crétin. La couleur de la peau, c'est un panel qui dans toutes les populations, entre certains extrêmes, va du plus foncé au plus clair et si symboliquement on associe des propriétés particulières à ces nuances, rien ne justifie, à notre époque, d'y accorder un intérêt autre que scientifique ou esthétique. Prenons le cas le plus extrême, l'albinisme. Candice Duprix nous dit à ce propos, sur le site Grotius, que l'albinisme concerne
« 1 cas sur 20 000 naissances dans le monde et plus particulièrement les populations africaines et sud-américaines, déclenche des réactions très partagées selon les pays, les régions, voire d’une personne à l’autre.
L’albinos, qui en Europe passe quasiment inaperçu, suscite, a contrario, de vives émotions en Afrique. En effet, sur ce continent, la symbolique attribuée à cette maladie a connu de nombreuses variations historiques : du protégé du roi, au mauvais présage, en passant par l’enfant des dieux des eaux ou au fantôme de l’homme Blanc. L’albinos est alors caractérisé par une identité ambivalente et tripartite, partagée entre le céleste, le terrestre et une association à l’homme Blanc. L’albinisme n’a alors jamais pu être banalisé et occulté en Afrique où la maladie semble avoir un impact socio-culturel beaucoup plus important.
D’une part, cette blancheur caractéristique de l’albinisme ne peut être qu’en contraste direct avec l’Afrique, souvent présenté comme un monde de couleur. D’autre part, la naissance d’un enfant albinos a très souvent un fort impact psychologique sur sa famille, qui déclenche la plupart du temps un sentiment de honte, de mépris et de rejet, allant parfois jusqu’à l’infanticide. »
C'est triste c'est sûr d'en arriver à là, mais enfin, notre propos se limite à dire que maladie ou pas, des peaux claires, il y en a eu partout, qu'un symbolisme particulier ait été attaché à cela n'est pas étonnant, que des voyageurs européens y aient été particulièrement attentifs non plus, cela ne prouve pas que l'on puisse montrer par là que d'autres européens se sont installés avant Colomb sur le sol américain pour, plus étrange, se fondre dans les tribus autochtones. Cependant il a raison sur un point. D'autres avaient touché le continent : l'empereur chinois Zheng He , en 1421, lance des expéditions dans tout le pacifique pour ouvrir des pistes commerciales. 5 ans d'explorations brutalement abandonnées à cause de la mort de cet empereur et de terribles famines, qui obligèrent son descendant à abandonner ce projet d'ouverture et à entamer le repli sur soi de la Chine. On ne peut pas dire que ce soit comparable à la découverte et à l'installation durable des conquistadors cependant. Ni expliquer la peau claire de certains habitants, qui s'explique par … la peau elle-même.
THE FALL OF THE HOUSE OF USHER
Son deuxième argument consiste à regarder Atlanta. Bon, et bien faisons ça, regardons Atlanta, voyons si ça nous dit quoi que ce soit de la gravité.

Alors oui, ce sont des immeubles. Oui, ils sont sans doute très élevés. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par là … Des immeubles élevés seraient impossibles si la gravité existait ? Ils sont tous parallèles les uns aux autres donc la terre est plate ? Soit l'un soit l'autre, soit les deux, mais dans les deux cas, c'est douteux. Sans gravité, il planerait à 300 mètres depuis son premier dunk. Alors bon … Jamais il n'aurait pu mettre de panier, on retrouverait nos chaussettes au plafond en nous réveillant et jamais les immeubles ne s'effondreraient lors des diverses avanies qui peuvent arriver. Peut-être est-ce que tout tombe par l'effet de son propre poids alors là c'est autre chose, on peut considérer ça, sans souci, et dire qu'aucune force n'attire les choses, mais c'est alors qu'il faut se faire un peu Virgile. Et rouvrir nos vieux livres d'école, ce que Shaq ne fait plus depuis longtemps de toute évidence. Expérimentons, on va voir c'est pas sorcier. Invitons Shaq à prendre des objets de divers poids. Un ballon de Basket-ball, il connaît bien, 600g environ, un medecine-ball de 10 kg, un piano à queue Steinway, 400kg, pour se la jouer Acme et la maison Usher, qui comme tout le monde le sait a la fâcheuse tendance à chuter. Je ne connais pas son poids, mais des experts ont estimé à 45 tonnes la maison de Karl dans le film Pixar Là-Haut, alors prenons ça. Rendons-nous à Atlanta, puisque cette ville fascine notre perdu préféré, et par une après midi claire, sans vent, allons au sommet de l'immeuble le plus haut. C'est le Bank of America Plaza, et heureusement pour nous, il dispose d'un toit plat sous son obélisque. Donc jetons tous ensemble le ballon de basket-ball, le medecine-ball, le piano et la maison Usher, en même temps et exactement de la même hauteur, ils s'écraseront en même temps au sol. Bien sûr, avec les frottements de l'air, les objets plus légers risquent d'être freinés, il faudrait pouvoir faire ça sous vide-air, mais enfin, si Galilée l'a fait du haut de la tour de Pise, nous, on peut bien se permettre aussi. Que nous dit ce résultat idéal ? Que la masse ne joue en rien dans la chute des corps, que c'est autre chose qui joue, et qui agit de la même manière exactement sur tous ces objets de poids différents. Très exactement : la force d'attraction de la terre. On peut faire ça de partout, même chez soi, ça fonctionne : la boule de pétanque tombe aussi vite que le playmobil, la tartine aussi vite que le chat. La maison blanche aussi vite que le faucon noir.
Il y a là de quoi secouer Shaq. Enfin, de quoi secouer ses certitudes au moins, les faire tomber une à une autour de lui comme des noix de coco pour le jeter dans cet état de trouble que connaissent bien les interlocuteurs de Socrate dans les textes de Platon.
Et c'est là qu'il faut changer de casquette, se faire Virgile. Car on est sur le point d'aboutir à quelque chose de grand. Sur la verge comme disent les anglophones. Car là, au milieu du désastre de ses pensées, Shaq n'est pas encore totalement perdu, comme un morpion venu sur le mont, il lui reste un argument cependant, auquel s'accrocher, le dernier qui lui reste, de toutes ses forces : les immeubles de la mystérieuse cité d'Atlanta restent désespérément parallèles les uns aux autres et il a voyagé à travers tout le pays, et ce pays est plat pour lui. Comme pour Jacques Brel d'ailleurs, qui n'est pourtant pas un conspi. C’est là-dessus qu’il faut se pencher maintenant.
0 notes